
Pauses by Noise
Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

Quand le corps réapparaît…
On attendait ce moment avec impatience ! Au printemps, on avait laissé une maison dans le Berry, alors qu’on s’apprêtait à commencer la rénovation de la salle d’eau. Il y a quelques jours, on a passé un long week-end à redémarrer le chantier.
Sauf qu’entre-temps, pandémie de Covid-19 et confinement. Comme des millions de Français, on est resté devant notre ordinateur à travailler sur Zoom. Le peu d’exercice que l’on faisait, du yoga et un peu de vélo pour se déplacer dans Paris, tout ça a vite été oublié. Le corps est devenu quasi superflu. Qui ne sert pas à grand chose. Et c’est comme ça un peu partout dans le monde, nous sommes entrés dans l’ère de l’humanité assise !
Sans le remarquer, n’est resté de notre corps que le buste et le visage, visibles occasionnellement à l’écran. Cette crise n’aurait été, au fond, qu’un accélérateur de notre disparition charnelle.
En quelques jours, nous sommes devenus des hikikomoris occidentaux, ces adolescents japonais qui s’enferment dans leur chambre et qui n’en sortent plus, pendant des semaines, voire des mois… mais qui sont, en revanche, en lien avec le monde entier via les réseaux sociaux.
Disparition du corps d’un côté, et de l’autre extrême attention par peur d’attraper le Covid. Le corps comme lieu de tous les dangers, de toutes les menaces… alors qu’il avait déjà plus ou moins disparu.
Alors la semaine dernière, on s’est dit qu’il fallait commencé tôt pour avoir le temps de finir le sol de la salle d’eau, avant le déjeuner. On s’est dit que l’on allait être sur le chantier à 7 h 30. Une grande matinée pour découvrir et peaufiner la pose du carrelage. On avait tout prévu. Le matériel, la gourde d’eau, la radio.
Tout prévu, sauf qu’au bout de trente minutes, on a ressenti une douleur qui s’est manifestée avec insistance, qui s’est généralisée à tout le corps. On ne passe pas de l’écran de l’ordinateur à la maçonnerie, par un clic de souris. Poser du carrelage est particulièrement éprouvant pour les genoux, pour le dos et pour les bras qui tiennent à distance les carreaux à placer.
Au bout d’une heure de pose, on s’est relevé. On a soufflé, prenant conscience de quelque chose de simple, de très simple. Que l’on n’est pas seulement une tête pensante, un doigt à clic et un regard attentionné. On est aussi un corps, et ce corps, il faut l’entretenir, le soigner, le protéger, si l’on veut qu’il nous porte encore un moment. Ce corps, il nous appartient et il faut tout simplement l’aimer.

Anniversaire déconfiné
« Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez tous là, pour mes 50 ans ! » On redoutait un peu les dîners entre amis, trois semaines après le déconfinement. À se demander comment on allait gérer les masques, les distances de protection, les gestes barrières. On allait être combien ? Dix, vingt, peut-être plus ?
Dans cette grande maison de Bagnolet, on était habitué à se retrouver à plus de cinquante, mais ce soir, beaucoup ont décliné l’invitation de Joëlle, par peur du nombre, par peur d’attraper quelque chose !
Dès notre arrivée, le bonjour est à distance, signe de la main pour certains, sourire complice, salut du coude pour d’autres. Tout se passera sur la terrasse, barbecue dans un coin. « Allez, c’est l’apéro ! » Et les premières remarques. « Non mais là, si tout le monde pioche dans le bol d’olives avec les doigts ou utilise le même couteau pour tartiner la tapenade, on est bon pour le Covid ! »
Julien qui s’est occupé de la viande de porc frottée au piment d’Espelette surveille la braise, et tout le monde s’installe à table. Rapidement, les discussions s’électrisent au rythme des déplacements des bouteilles de vin, qui passent de main en main. On trinque encore et encore, les verres s’entrechoquent. « Ça va, non ? On peut trinquer !» « C’est pas très gestes barrières, tout ça ! »
« Non, je ne suis pas macroniste, tu retires ce que tu viens de dire ! ». Les chaises se rapprochent, les confidences à l’oreille, tenir la main de l’autre, lui taper l’épaule. Troisième tournée de travers de porc agrémentés de merguez que l’on mange comme des biscuits à la cuillère. Et là, réaction d’Adeline : « Je ne m’étais pas rendu compte avec le confinement que j’étais devenue presque végétarienne. Qu’est-ce que c’est bon, la viande, avec un grand verre de rouge ! »
On change de place pour parler avec Joëlle. « Non mais François, ça ne va pas du tout. Tu es en train de manger dans l’assiette de Christophe, et avec ses couverts en plus ! »
Et le gâteau arrive, que tout le monde applaudit, en chantant « happy birthday ». Champagne ! On embrasse Joëlle, on se prend dans les bras, quel plaisir, mais quel plaisir de se retrouver. Et les discussion repartent jusque tard dans la nuit.
Il faut rentrer et l’on remet le masque que l’on avait déposé près de la porte. Sauf qu’en arrivant à 20 heures, on avait un masque avec une gazelle bleue et qu’il n’en reste plus qu’un avec des fruits rouges. Sans doute celui de Régis… qui est parti avec le nôtre sur le nez !

La longueur des cheveux
Depuis le 11 mai, les héros du confinement ont passé le relais aux véritables sauveurs du déconfinement, les coiffeurs !
En première ligne et bravant le danger de l’épidémie de Covid-19, il y a eu les héros du confinement. Sans eux, rien n’aurait été possible durant ces 55 jours. Médecins, infirmières, commerçants, caissières, éboueurs, taxis, livreurs de repas… Depuis le 11 mai, ils ont passé le relais aux véritables sauveurs du déconfinement, les coiffeurs !
Fin avril, quand le président de la République a annoncé la date de sortie, nombre de Français ont décroché leur téléphone pour prendre rendez-vous.
« — Oui, bonjour Sophie, comme je suis contente de pouvoir vous parler. Je souhaiterais prendre rendez-vous pour le lundi 11 mai, au matin. Comment ? Ça ne va pas être possible avant le samedi 16 à 18 heures ? Mais Sophie, vous ne vous rendez pas compte, ma couleur est catastrophique, je ne peux pas sortir comme ça ! »
En quelques semaines, tout le monde a mesuré l’importance d’une profession souvent ignorée, pour ne pas dire, moquée. Ce n’est pas complètement « Startup nation » et économies numériques que de se pencher sur les mèches, les franges et le brushing de madame Parmentier.
En temps normal, le cheveu, c’est un million de Français qui se rendent, chaque jour, chez leur coiffeur. C’est le deuxième secteur de l’artisanat, après le BTP.
Durant 55 jours, certains ont été tentés de braver les interdits, en se lançant dans la pratique intuitive des ciseaux avec quelques catastrophes en vue. Rien n’y a fait, la coloration pour les nuls, le tuto frange, ou le tuto tondeuse à pratiquer avec parcimonie…
Le cheveu, c’est deux centimètres par mois, donc logiquement après deux mois, c’est comme une pelouse qui n’a pas été tondue. L’oreille qui était toujours bien dégagée s’est retrouvée engloutie sous le poil.
Chez les hommes, c’est souvent une question de dignité, voire d’identité. Pour tout ceux qui travaillaient en vidéoconférence, cela tournait à l’humiliation, à chaque connexion Zoom. Côté femmes, avec quatre centimètres de repousse, la moitié des blondes sont quasi devenues brunes, faute d’entretien de la couleur.
Le 11 mai au matin, c’est toute une vie sociale qui a repris.
« Oui, bien sûr, le confinement, la privation de liberté… mais moi je vais vous dire, ce qui m’a le plus manqué, c’est de parler avec ma coiffeuse. Ça fait plus de quinze ans que tous les vendredis, je parle avec Sophie, elle connaît tout de ma vie… c’est un peu ma psychanalyste à moi ! »

Le monde d’après…
Ça y est nous y sommes, les 55 jours de confinement n’étaient finalement qu’un sas de transition, une sorte de palier de décompression pour enfin pouvoir découvrir… le monde d’après, the world after.
Dimanche 10 mai, pour les applaudissements de 20 heures, ce fut plus long que d’habitude. Les voisins du 32, qui ont mis en musique tous les 20 heures du confinement, ont passé le tube “Born to be alive” de Patrick Hernandez. Comme un signe, un mantra, “naître pour être vivant, pour vivre !”… 1978, c’était les années Palace, les années festives, l’insouciance et l’euphorie où tout était possible. C’était avant les années sida qui engloutiraient cette joie de vivre. Lundi 11 mai, au premier soir du déconfinement, pas d’applaudissements aux fenêtres, pas de disco pour soutenir le personnel soignant. Il faisait même un peu frisquet à 20 heures.
On nous a vendu l’espoir, la solidarité, l’attention à l’environnement, la décroissance à portée de main et l’on découvre l’inconnu et l’incertitude, comme dans “Le Prisonnier” (The Prisoner), cette série télé anglaise culte de la fin des années 1960 que l’on regardait enfant. Un ancien agent des services secrets britannique se retrouvait dans un village aseptisé, ressemblant au monde extérieur mais dont il ne pouvait pas sortir. Chacun se saluait poliment d’un “Bonjour chez vous”.
Dans notre monde d’après, masqué de près, une expression flotte en permanence au-dessus de nos têtes, comme un étendard : distanciation sociale. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, dés lors que vous vous tenez à distance des autres. On va bien évidemment vous y aider, en mettant au sol des marquages matérialisant ce mètre indépassable. » Oui, bien sûr, et pourtant, ce mot nous met mal à l’aise. Car il ne s’agit pas vraiment de distanciation (comme au théâtre) et elle n’est pas sociale. Distanciation sociale qu’on le veuille ou non, c’est très différent d’“éloignement physique” qui aurait été sans doute plus juste. C’est le mot social qu’on ne comprend pas ou plutôt si, on a peur de comprendre ce que l’on voit, depuis le début de cette pandémie : une accentuation des inégalités. Car s’il y a une chose qui a vite émergé de ces 55 jours, c’est le besoin des autres, le besoin d’être ensemble et l’attention portée à tous.
Lundi soir, avant la fermeture du Monoprix, on est passé chercher quelques bières pour retrouver des potes. Et là, grosse surprise, le rayon chips et cacahuètes était entièrement vide. Beaucoup, beaucoup plus rassurant sur la nature humaine que les rayons vides de PQ, au mois de mars !

Tout ça a commencé par une poignée de main
La pandémie de Covid-19 remet en cause la poignée de main. Mais quelle est l'origine de ce geste de salutation ?
Et dire que tout ça a commencé par une poignée de main. Une chauve-souris, un pangolin, un mec qui se cuisine un ragoût. Qui rencontre quelqu’un, le lendemain, pour du business et qui lui serre la main. Le début de la pandémie de Covid-19.
Mais ça vient d’où, la poignée de main ? Car ce n’est pas commun à toutes les cultures et beaucoup sur la planète préfèrent garder une distance : se saluer sans se toucher. Et ça remonte aux temps anciens. À la légende !
À l’origine, on pratiquait la poignée de main pour prouver à l’autre que l’on venait sans arme dans la main, une façon de montrer sa bonne foi. Cela permettait également de vérifier que l’autre ne cachait pas un poignard dans sa manche. Et pendant des siècles, ce geste de salutation ne sera réservé qu’à la diplomatie et à la politique.
Et c’est très tard, au XIXe siècle, dans le monde paysan, que ce geste s’est démocratisé, en devenant un geste de négociation, au quotidien. « Tope là pour ce bœuf. D’accord pour cette remorque de blé d’hiver ! ». Un signe qui permettait de se mettre à l’égal de l’autre, en confiance, une façon de congratuler l’autre. Ce n’était plus une révérence hiérarchique comme avant. Avec ce geste, l’égalité républicaine prenait le dessus.
Pourtant, dans de nombreuses cultures, ce rapport à l’autre n’est pas si évident. Il y a des civilisations de contact entre les individus et des civilisations de la distance. Dans beaucoup de cultures asiatiques, les salutations se font sans aucun contact, les personnes placent leurs mains près de leur visage. En Inde, le namasté (« Je m’incline devant toi » en sanskrit) se fait les mains jointes au niveau de la poitrine. En Thaïllande, le wai sert de salutation autant que de remerciement. Plus les mains sont hautes, plus le respect témoigné est important. Au Japon, c’est une courbette dont la hauteur varie selon le statut de l’interlocuteur.
La poignée de main est une formule intermédiaire, on garde une certaine distance avec l’autre, 80 cm, 1 mètre, tout en établissant un contact physique limité à une partie du corps.
Avec le commerce et la mondialisation au XXe siècle, la poignée de main s’est imposée dans les échanges. L’Asie est devenue un continent puissant économiquement. Un partenaire avec lequel la négociation est rude. Les Chinois, les Coréens ont, petit à petit, tendu la main vers l’autre. Tout ça a commencé par une poignée de main.

Tous les soirs à 20 heures
A 20 heures, à sa fenêtre, on applaudit pour soutenir le corps médical, face à la pandémie de Covid-19. Tiens, on n 'a pas toujours pensé au personnel soignant…
Il a fallu quelques heures, le soir même du début du confinement, le 17 mars, pour que cela devienne un rituel…
Il a suffi d’un message sur Twitter, #OnApplaudit, pour que chacun ouvre sa fenêtre à 20 heures et acclame, durant plusieurs minutes, tout le personnel hospitalier qui est en première ligne dans le combat contre le Covid-19.
Les premiers de cordée, les vrais, ce sont tous ces acteurs du corps médical qui tiennent les digues, depuis trois semaines, pour que la vague de malades les plus graves n’emporte pas tout sur son passage. Sur Twitter, une infirmière : « J’ai vu vos vidéos, et ça m’a incroyablement touchée. Merci pour nous. Prenez soin de vous. »
L’initiative est née en Italie, un pays qui vit un véritable drame avec la pandémie de coronavirus. Dés les premiers jours de mars, les Italiens, debout sur leurs balcons, entonnaient l’hymne national. Cette initiative a ensuite été reprise partout dans le monde, de l’Espagne à la Turquie, en passant par l’Argentine et la Serbie.
« C’est tout ce que je peux faire, rester chez moi, et à 20 heures me mettre à la fenêtre avec mes enfants et applaudir, applaudir toutes ces personnes dévouées qui sont en première ligne. »
Applaudir à sa fenêtre, c’est aussi l’occasion, quand on est resté cloîtré chez soi, de découvrir ses voisins de l’immeuble d’en face, même de loin. Cela fait du bien. On s’entend, on se voit, et d’un soir à l’autre, on se reconnaît. C’est un bras tendu vers le voisin d’en face, sans danger et sans risque.
C’est peut-être aussi ça, le paradoxe. On ouvre sa fenêtre autant pour le corps médical que pour soi, pour se rassurer de ne pas être seul. On applaudit quand il y a un vis-à-vis. On applaudit dans les villes, très peu dans les campagnes françaises.
Sur Twitter, une autre infirmière : « Tant mieux s’il y a une prise de conscience sur ce que vivent les soignants depuis des semaines, mais, malheureusement, les applaudissements à eux seuls ne feront rien contre le virus. L’urgence, c’est juste de rester tous chez vous, en applaudissant si vous voulez. Si vous voulez sauver des vies, nos vies et les autres : restez chez vous ! »
Alors évidemment, on a vu passer un autre tweet, « pour toi qui vote Macron et qui nous applaudis à 20 heures », avec quatre aides-soignantes faisant un doigt d’honneur…Le détournement politique d'un cliché, où à l'origine les quatre jeunes femmes faisaient un doigt d'honneur au Covid-19.
On habite le 11e à Paris. Lors de l'élection présidentielle de 2017, Macron a remporté 92,69 % des suffrages au second tour, avec l'appui de LR et du PS. Un beau score pour ceux qui détruisent méthodiquement les services publics depuis des années. On va quand même ouvrir les fenêtres ce soir, on votera mieux la prochaine fois.
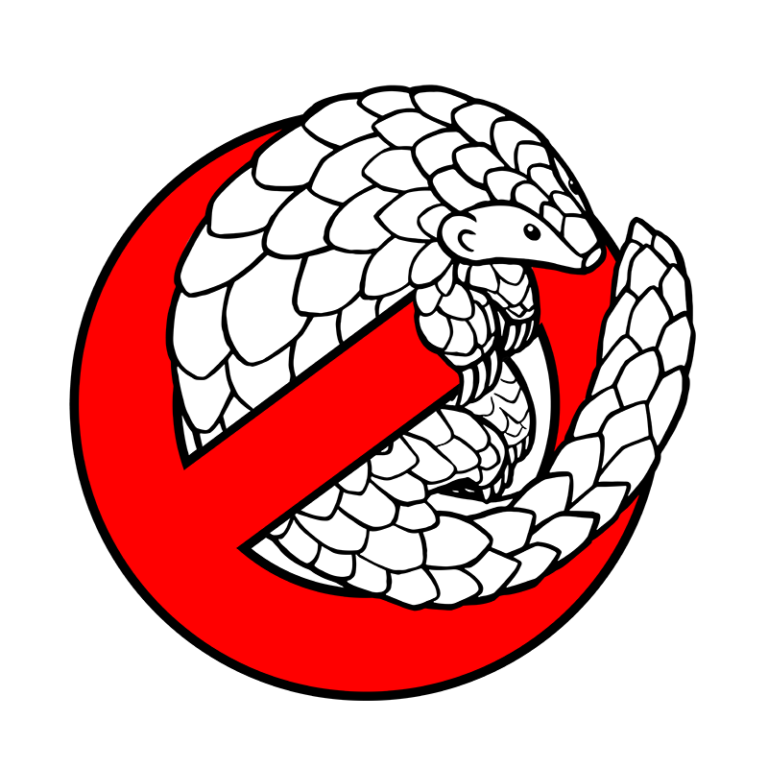
SOS pangolin
L’origine de la pandémie de covid-19 ? Le pangolin infecté par la chauve-souris ? La Chine a dû interdire la consommation de tous les animaux sauvages…
Alors c’est quoi cette histoire de pangolin, de chauve-souris et de bestiole qui pourraient être à l’origine de la pandémie de covid-19 ?
Une chauve-souris enragée, un manoir lugubre, une nuit de pleine lune, un pangolin mâle, le sang et puis le hululement des chouettes. En Chine, pas dans les Carpates. En Chine, où l’on mange tout et n’importe quoi, comme nous autres Français avec nos assiettes d’escargots, de grenouilles et d’andouillettes. Arrive Tchang qui descend de sa voiture (oui, Tchang, comme dans « Le lotus bleu » et « Tintin au Tibet »). Il vient d’appeler deux investisseurs avec lesquels il a monté un business d’export de jouets qui a franchement cartonné, Noël dernier.
Pour fêter ça, Tchang a une idée en tête, un ragoût de pangolin arrosé d’alcool blanc. Sauf que le pangolin, encore faut-il le trouver. Cet animal sauvage est protégé, car menacé d’extinction. C’est donc à un intermédiaire, en contact avec des braconniers hongkongais, que Tchang s’est adressé. Le pangolin, c’est l’animal le plus braconné au monde.
Entre 500 000 et 2,7 millions de pangolins sont capturés, chaque année, dans les forêts d’Asie et d’Afrique. Cette espèce de dinosaure couvert d’écailles, les Chinois, ça les rend complètement dingues, comme en Afrique la viande de brousse, le singe par exemple, ou bien chez nous, le gibier, lièvre, sanglier, chevreuil.
Dans le pangolin, les Chinois mangent tout, absolument tout. La viande, en fricassée ou longuement cuisinée en sauce. Les écailles, certains en font des bouillons, pendant que d’autres les transforment en poudre pour leurs pouvoirs aphrodisiaques et leurs qualités médicinales supposés. Le sang également, aux vertus anti-inflammatoires et anticoagulantes, que l’on boit allongé d’alcool. Et même les fœtus, recherchés par les médecins. Enfin la langue, plus longue que le corps de l’animal, ça c’est le must.
Les prix sont délirants, le kilo de viande de pangolin se négocierait à plus de 1 000 dollars. Et Tchang en a trouvé presque un kilo, c’est quasi inespéré. Car début janvier, une rumeur a commencé à courir, ce petit animal aurait pu servir d’hôte intermédiaire dans la pandémie de coronavirus. Un schéma classique : une chauve-souris qui mord un pangolin qui transmet à l’homme. Et en quelques jours, c’est toute la région de Wuhan qui se retrouve infectée. C’est l’effet papillon doublé de l’effet pangolin.
Fin février, la Chine a annoncé l’interdiction de la vente et de la consommation de tous les animaux sauvages. Le comble, c’est peut-être le covid-19 qui va sauver le pangolin de l’extinction !
En attendant, Tchang vient de laisser un message codé très court à ses deux associés. Hors de question de laisser des traces : GALOPINN_21h.
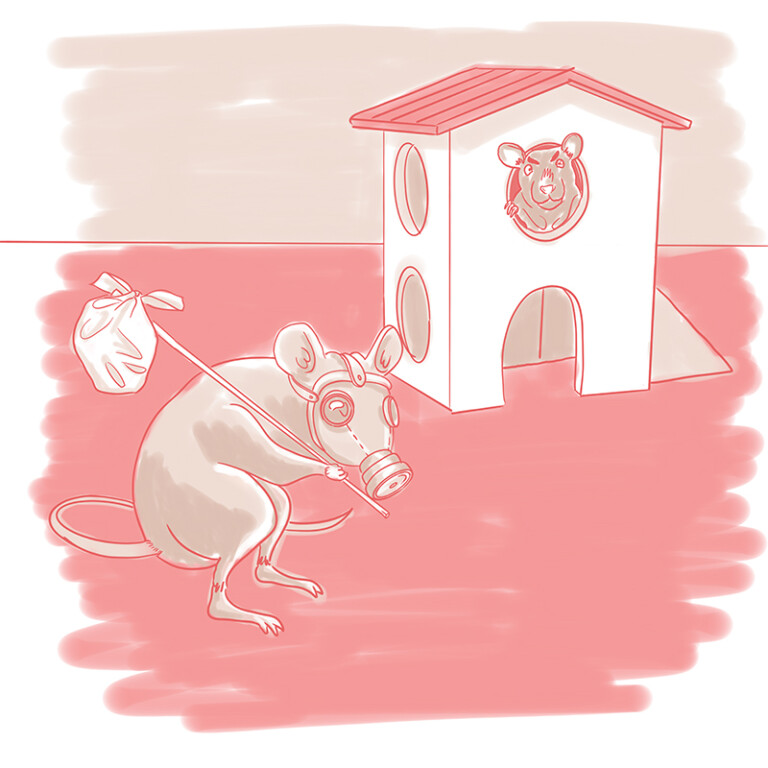
Rat des villes, rat des champs
Suite au confinement dû au Covid-19, des milliers de citadins sont partis se réfugier à la campagne. La cohabitation avec les locaux n'est pas facile.
Il n’a pas fallu attendre longtemps, pour constater que la crise sanitaire, due à la pandémie de Covid-19, était un incroyable révélateur de notre société.
Sitôt la confirmation du confinement annoncée par le président de la République, on a vu une partie des Français ranger leurs affaires et partir se réfugier dans leurs résidences secondaires. Par la route ou par le train. Ces privilégiés ont fui les grandes agglomérations, Paris mais aussi Lyon, Bordeaux, Nantes, suivant les recommandations anciennes d’Hippocrate, le père de la médecine : “En cas d’épidémie, partir vite, loin, longtemps et revenir tard !”
En région parisienne, c’est environ un million de Franciliens qui ont déserté.
L’exemple de Belle-Île-en-Mer est confondant. Une île où aucun cas de Codiv-19 n’était signalé avant l’annonce officielle et qui voit débarquer le mardi 17 mars, environ 600 Parisiens. En quelques heures, ils vont vider les supermarchés et remplir leurs congélateurs. Le Carrefour Contact du Palais, la commune principale de l’île, a multiplié son chiffre d’affaires par quatre. Effrayés, beaucoup de locaux craignent qu’en cas de crise, le modeste hôpital soit complètement engorgé. Et le lendemain, de voir les parisiens préparer les vélos pour faire de belles balades à travers l’île. Des pique-niques sur les plages…
Malgré la douceur printanière, les invectives ont vite fleuri sur les comptes Facebook d’insulaires en colère : « Rentrez chez vous », « Vous nous apportez le virus », « Allez passer vos vacances ailleurs », « Vous allez saturer nos hôpitaux ». Sur l’île de Noirmoutier, ce sont les voitures immatriculées 75 qui en ont fait les frais… les quatre pneus crevés.
La semaine passée, à Belle-Île, le maire du Palais assurait que, après quelques jours de vives réactions « les tensions étaient un peu retombées ». Les contrôles policiers se sont renforcés et la prise d’arrêtés municipaux interdisant l’accès aux plages, promenades à vélo a permis à chacun de retrouver le calme et la raison.
Une mère de famille du 11e arrondissement parisien assure qu’« il n’est pas question pour nous de venir ici pour contaminer quiconque. Depuis notre installation, on se calfeutre, en profitant du jardin le matin, quand le soleil donne sur la terrasse. Mais regardez, les hortensias sont magnifiques ».
À Kergolay, à l’est de l’île, on a appris qu’un musicien professionnel venu de la capitale, un joueur de cor d’harmonie, s’était vu signifier par son voisin électricien que « le cor de chasse à 20 heures, ce n’était pas possible, que les gens sur l’île ont besoin de calme ! On n’est pas à la Philharmonie ici. »
L’autre voisin parisien de notre musicien est par contre, lui, aux anges, pour savourer le calme du confinement.

Tous confits dans le PQ !
Pandémie de coronavirus. Pourquoi les gens se sont-ils rués sur le papier toilette ?
Ce mercredi matin, 10 heures, et l’on se dit que l’on va aller faire des courses au supermarché du quartier. De vraies courses pour la semaine où l’on remplit un grand caddie, plus un sac, pour éviter de ressortir au bout de trois jours, confinement oblige.
À l’extérieur, la queue est modeste, cinq personnes qui respectent bien les distances de sécurité, en raison de la pandémie de coronavirus. On entre un par un, au fur et à mesure qu’une personne sort.
À l’intérieur, tout le personnel porte un masque, les caissières sont protégées derrière un écran de Plexiglass. On traverse le magasin et là, surprise, les rayons sont pleins. Des pâtes, du riz, du lait, des conserves en masse. Quand on arrive dans l’allée des produits ménagers, changement d’ambiance… quatre linéaires entièrement vides. Plus un seul rouleau de papier toilette. « Ah oui, quand même, mais qu’est-ce qui pousse les gens à acheter massivement du PQ ? »
On pose la question au magasinier qui remplit les rayons. « C’est tout bête, mais les rouleaux de papier toilette sont volumineux. On ne peut pas mettre plus de 50 à 60 paquets par rayon, donc ça disparaît très vite, en faisant un gros trou dans les linéaires… Et les gens se disent qu’il y a une rupture de stock et donc achètent massivement. Vous voyez là, je remets des boîtes de conserves, du maïs, des haricots, c’est plus petit, et je n’aurai pas besoin de revenir réapprovisionner avant le milieu de la journée. Avec le papier toilette, il faudrait que je revienne toutes les demi-heures. »
Ok, mais quand même, pourquoi le PQ et pas les gros paquets de pâtes ? Le PQ, c’est logiquement l’hygiène pour effacer le sale. On voit bien qu’aujourd’hui, tout le monde cherche à se protéger et qu’il n’y a rien à se mettre sous la main. Pas de masque, peu de gel. Et l’on nous dit que le plus efficace, c’est de se laver les mains, régulièrement, mais ça ne suffit pas, c’est pas concret, c’est pas identifiable le laver de mains.
Il y a sans aucun doute un truc avec le sentiment de dégoût. Et ce qui est très accessible, pas cher et très volumineux, c’est le rouleau de PQ. C’est facilement identifiable et ça rassure. L’antidote du dégoût. « Le matin, j’ouvre le placard au dessus du lavabo et waouh, qu’est-ce que ça fait du bien de voir ces gros paquets de PQ. »
Le gros paquet de 12 rouleaux de papier toilette ultra résistant et double épaisseur est devenu l’icône de la panique collective. Et tout ça, pour le prix d’un petit flacon de gel hydroalcoolique.
Sauf que l’on ressort du supermarché, pas complètement convaincu, en se posant quand même la question : « OK, mais moi, je fais comment sans papier toilette ? »

Et tu fais quoi ?
Depuis lundi dernier, on passe beaucoup de temps au téléphone. Pour tout avouer, par facilité, on avait pris l’habitude des mails et des textos.
Depuis lundi dernier, la voix des proches est devenue très importante. On a entendu Jean-Louis Murat en parler et l’on a été conquis : « La voix est notre miroir, encore plus que le regard, certainement plus ! Si je vous écoute, je sais beaucoup plus de choses de vous que si je vous regarde. »
Alors on a parlé, on a écouté…
— Je ne bois plus que deux cafés le matin.
— Je voulais prendre rendez-vous chez le coiffeur, la semaine dernière, et puis j’ai oublié et là, avec le confinement, non mais tu te rends compte, à quoi je vais ressembler dans quelques semaines !
— Alors on s’est dit, on va agrandir l’appart, on va mettre les fleurs sur le palier et dans l’escalier, comme ça, en fin de journée, on sort juste cinq minutes sur le pas de la porte et on a l’impression d’être au jardin, c’est cool !
— J’avais pas compris au départ, mais pour les ados, le confinement, c’est pas le problème. Le problème, c’est le confinement AVEC leurs parents.
— J’ai reçu un mail de Brigitte et figure-toi qu’elle a signé “Bonne vie confite”, j’ai pas trouvé ça hyper positif, non ?
— Moi, je vais à l’atelier, j’ai du boulot, je peins des roses pour un décor en trompe-l’œil, et je passe huit heures à peindre. C’est pas de masque dont on a besoin, c’est de fleurs. C’est des roses qu’il faut distribuer, pour que les gens restent à la maison.
— Moi, ça me saoule, les gens qui courent en bas dans la rue. Ils te disent : “J’ai trop besoin de me défouler, de courir !” Non, mais les mecs, ça fait une semaine. C’est pas comme si vous étiez retranchés dans une cave depuis trois mois… ça fait une semaine. Les Jean Moulin du jogging, c’est bon !
— Les attestations, je ne les imprime pas. Je demande à mes gamins de les recopier à la main, ça les occupe.
— C’est marrant, il y a encore quelques jours, on nous bassinait du matin au soir, avec l’intelligence artificielle, les algorithmes, la virtualité… On les entend plus trop ceux qui nous prenaient pour des gros beaufs, des attardés de la start-up nation. C’est très basique ce qu’on vit, c’est pas virtuel du tout, soit on s’en sort, soit on crève.
— Et tu fais quoi ? Tu en profites pour terminer le bouquin que tu as commencé à écrire, il y a deux ans ? Non ? Ah, rien du tout ? Tu en profites pour ne rien faire du tout ? C’est bien aussi, finalement !

Le silence du premier soir…
Pandémie de coronavirus. Au premier soir du confinement, un silence assourdissant nous entoure. Nous ne pouvons plus voir nos proches…
Mardi 17 mars, minuit, première nuit du confinement. On ouvre la fenêtre de la chambre qui donne sur l’avenue de la République à Paris. “Un silence assourdissant” comme écrivait Albert Camus dans « La Chute ». La semaine passée, un autre livre de Camus s’était très bien vendu, « La Peste ». Les mots nous suivent, nous accompagnent. Les mots des écrivains nous aident à vivre le quotidien.
Dans la nuit, pas une voiture. Seul, un homme marche un sac à la main. Pas un bruit, on ne sait pas où il va. Voilà, on en est là avec la pandémie du covid-19 qui se répand comme un nuage invisible sur toute la ville.
Durant la journée, dans l’immeuble d’en face, les gens étaient devant leur fenêtre, ouverte. A regarder, à simplement regarder la rue. Fumer une cigarette en regardant dehors. Pour ne pas trop se sentir enfermé. Pour respirer.
En deux jours, on est passé d’un vote démocratique pour les municipales, à une restriction des libertés comme personne en France n’en avait connu, depuis la Seconde Guerre mondiale. On a demandé aux gens de faire l’effort d’aller voter dans la journée. Le soir, au journal de 20 heures, les élections étaient bien loin. Quel pourcentage, dans quelle ville, la droite, la gauche, les écolos, LRM, le RN… la pandémie était dans tous les esprits, les résultats de tel ou tel parti n’ayant plus aucun intérêt.
Ne plus pouvoir sortir dehors, ne plus pouvoir faire ce que l’on veut, et peut-être, le plus difficile, ne plus pouvoir voir ceux qui nous sont chers. Ce soir, au journal télévisé de France 2, le Premier ministre Édouard Philippe a répondu à une question sur la possibilité de se rendre à l’enterrement d’un proche. « Ce que je vais vous dire est très difficile, terrible à entendre, mais non, vu la gravité de la situation, on ne peut pas se rendre à un enterrement. Nous devons limiter au maximum nos déplacements ! » L’étau se resserre comme jamais.
Alors bien sûr que l’on a testé les discussions sur Skype. Mais c’est tellement différent, cela reste de l’image et l’on ne s’y fait pas. On a le sentiment de parler tout seul devant un écran qui bouge. Sur Skype, on ne sait pas comment terminer une discussion, sans faire disparaître l’autre… On n’est pas sûr de renouveler l’expérience. On préfère téléphoner, la voix paraît plus proche.
On apprend dans la soirée que demain, la Belgique adoptera un confinement généralisé.
En fin de journée, on a cru entendre un oiseau.

"C’est à moi de choisir ?"
On s’est tous retrouvés un samedi matin, au supermarché, avec son panier devant le rayon de café, à ne pas savoir quoi prendre. Le prix oui, bien sûr, mais pas que…
Brésil, Colombie, Guinée, Équateur, Honduras, Pérou, Costa Rica, Kenya, Éthiopie… « Ah oui, quand même, le nombre de pays où l’on produit du café, j’aurais jamais imaginé ! »
Alors on prend un paquet et c’est là que ça vrille, quand on découvre la petite mention « café issu du commerce équitable certifié ». Et on relit encore une fois, et là, on regarde à côté dans les rayonnages et l’on comprend quelque chose.
En gros, on comprend que les autres cafés sont produits par des groupes tout puissants, peu scrupuleux à accorder une rémunération juste aux petits cultivateurs. « Moi, j’en veux pas de ce café, je ne veux pas être le complice de ces multinationales. Ce n’est pas optionnel, ça ne devrait même pas exister, ce cas de conscience ! »
Ce qu’on comprend, c’est que là, dans le supermarché, on me demande de faire un choix individuel qui devrait logiquement être fait par la grande distribution. Le chocolat, les bananes, le thé issus du commerce équitable, le bio garanti sans OGM, le produit avec emballage recyclable… en gros pour chaque article, j’ai le choix. Choisir ce qui est bien, plutôt que ce qui est mal.
Sauf que le mal fait parti de mon choix. Que le mal exploitant les hommes ou la nature… tout ça est en vente libre, là sous mes yeux et que c’est à moi de me démerder avec mes états d’âme. Moi petit consommateur individuel.
Est-ce qu’un jour, on pourrait imaginer que l’on pense au bien collectif ? Est-ce qu’un jour, on pourrait imaginer que les États, les responsables politiques s’engagent concrètement pour le bien de tous ?
On ne peut pas laisser au consommateur le choix d’acheter du lait qui ne permet pas aux éleveurs de bovins de simplement vivre de leur travail. En invoquant la libre concurrence.
Bon, finalement, on a pris deux paquets de café d’Éthiopie « issus du commerce équitable certifié ». On aime bien les coureurs de marathon qui sont presque tous éthiopiens. Comment ? Oui, c’est vrai il y a aussi pas mal de Kényans sur la ligne d’arrivée…
Vous avez tout vu !
Une petite erreur au chargement