
Pauses by Noise
Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

La pilule rouge
Bon, ça y est, on a franchi le pas et on vient d’avaler la pilule rouge de “Matrix”. “Je suppose que pour l’instant tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc !”
Oui, comme Alice qui pousserait la porte du supermarché Amazon Go, tout juste ouvert au rez-de-chaussée du siège social du géant de l’e-commerce à Seattle. Et Morpheus de t’expliquer comment fonctionne ce magasin nouvelle génération, qui accentue encore d’un cran la logique cachée de notre société de consommation.
“À l’entrée, quand tu franchis les portillons, tu scannes l’application Amazon Go sur ton smartphone. Puis tu choisis des produits que tu mets dans ton sac. Voilà Neo, c’est tout. Tu as fini tes courses. En fait, des caméras à intelligence artificielle, des algorithmes d’apprentissage automatique et des capteurs de poids sur les rayonnages identifient ce que tu prélèves au fur et à mesure. À la sortie du magasin, la facturation se déclenche et ton compte en banque est directement débité via ton compte Amazon. Tout ça, sans que tu aies eu besoin de passer par une caisse, et pire de faire la queue !”
Vingt ans après la confusion virtualité/réalité de “Matrix”, les trois principes fondateurs de la consommation contemporaine sont en place. Et totalement exacerbés. Ça commence par la magie du sans contact, l’obsession de la société américaine. Pas de contact humain. Plus de caisse ni de caissière qui touche les produits et frustre l’envie par une “sanction” pécuniaire.
Ensuite, il faut que ça aille vite, toujours plus vite. S’éloigner une bonne fois pour toutes de cet acte d’achat traditionnel qui prend trop de temps… Laisser ça aux marchands du Moyen-Orient qui passent des heures à discuter, à négocier le prix d’un tapis. Pourquoi donner autant d’importance au fait de devenir propriétaire d’un produit ? Chez Amazon Go, le sans contact humain va tellement vite que la marchandise en devient quasi dématérialisée.
Enfin, troisième point, la virtualité prend le pas sur la réalité. On déambule dans un espace et l’on remplit un panier virtuel qui se trouve quelque part, là-bas au nord de l’Europe, dans le Cloud. Toujours cette allégorie du nuage où tout flotte avec légèreté.
On ne sait plus bien ce que l’on achète… et d’ailleurs, est-ce que l’on achète quelque chose ? Plus d’argent à sortir, plus de carte de crédit. La réalité est masquée par autre chose. On ne voit plus le travail, la matière première, le social, le politique. Ce ne sont plus des courses que l’on fait. Ce sont des émotions que l’on vit. La transaction, on l’oublie. Six autres Amazon Go devraient ouvrir, cette année, aux États-Unis…
La pilule rouge, elle est très efficace, elle te fait disparaître derrière le produit, le mec qui bosse dans un entrepôt Amazon. Car lui, son quotidien est bien ancré dans la réalité. À acheminer des marchandises sur des tapis roulants, à mouiller sa chemise derrière un chariot chargé de commandes. Il suffit de pousser la porte de l'un des centres logistique gigantesques de Amazon pour se convaincre que le cauchemar est bien du côté du réel.

Shazamer le café !
Il y a des matins à l'heure du café, le son est dense. Aucune idée de la fréquence radio, mais ce matin, c’est réellement brutal. Une batterie maltraitée par un bûcheron enivré et des guitares basses entre les mains de ceux qui savent envoyer du lourd.
Sauf qu’il est 9 h15 et que l’on ne sait pas ce que c’est que cette musique. Et va savoir pourquoi, on n’ose pas demander, car visiblement autour de la grande table, ça dandine sec de la tête devant les Macs. Et là, oui, bien sûr, on sort son smartphone, clic, Shazam, reclic et wahoooooo… mais on n’avais pas reconnu… c’est Lemmy qui chante en 1979, genre « Si y’en a qui se sont gourés de concert, on va vous exploser la gueule » avec « Overkill ».
Faut dire qu’en 79, on écoutait pas ça du tout. On écoutait Elvis Costello, les Clash de « London Calling », Depeche Mode, « Lodger » de Bowie, Bashung. Alors oui, évidement, Motörhead à côté, c’est du massif, et puis la découverte des Cure et leur pochette avec le frigo rose… ou encore Joy Division et « Unknown Pleasures » où tu restes médusé à la première écoute, et puis tu regardes s’il n’y aurait pas une tournée, des concerts parisiens, et tu apprends que le mec, il s’est pendu il y a pas longtemps.
Sauf que là, ce matin, grosse claque avec Motörhead que j’identifie en lançant Shazam, l’application de reconnaissance musicale.
Le fonctionnement est super simple, le téléphone capture un échantillon du morceau. À partir de cet échantillon, il créé une empreinte acoustique qui est comparée à la base de données de Shazam… et ça va très, très vite. En quelques secondes, deux, maxi trois, on a le résultat qui s’affiche… « Overkill ». Tout ça, à partir de quelques mesures de batterie. C’est quelque 20 millions de chansons qui sont « shazamées » tous les jours. Et après la musique, Shazam va s’attaquer aux images. On pourra identifier tout ce que l’on a sous les yeux. Dans un musée, un magazine, une affiche dans la rue.
Et, va savoir pourquoi, on réalise que si cette application arrive à trouver quasi instantanément un morceau de musique, il doit suffire de quelques mots pour identifier un appel téléphonique. Et donc, ça veut dire qu’aujourd’hui, on est capable de tout repérer d’une conversation. C’est tellement flippant qu’on va se reprendre une bonne grosse dose de Motörhead sans Jack Daniel’s, il est 9 h 20, quand même !

Rêver ensemble
Parler de tout, tout le temps. Entendre parler de tout. Sans plus savoir de quoi parlent les mots. Depuis l’arrivée du numérique, l’exhaustivité est devenue la règle.
Chacun est sommé d’avoir un avis sur tout et de le dire, de tweeter la bonne formule, celle que l’on diffuse en cascade sur les réseaux sociaux. Celle qui attire l’attention, mais ne cristallise rien.
On n’a pas perçu le changement, mais le regard a glissé. La vérité d’un fait a changé de nature, la vérité est aujourd’hui perçue comme une opinion. Et donc, n’importe quel élément d’information peut être contesté comme s’il s’agissait d’une prise de position. Bienvenue dans l’ère de la post-vérité, dominée par les croyances, l’émotion et les fake news.
Cette confusion fait objectif/opinion personnelle est devenue mortelle pour la presse. Dans cette faille, les journalistes indignés qui maîtrisent les codes d’argumentation à fort potentiel de buzz, ont pris le dessus. Définitivement. L’écume se révèle abondante et envahissante, les mots se font blessants. Frapper, choquer, humilier. Mais les lecteurs qui veulent simplement comprendre notre monde complexe et changeant, n’y trouvent pas leur compte. Une crise de visibilité.
En marge de ces torrents de commentaires, un hebdo tel “Le 1” est apparu comme une tentative de visibilité. Ce n’est pas un journal d’information, mais un journal d’inspiration. Un journal qui réconcilie littérature et actualité. Quand un écrivain s’empare de l’actualité, ce n’est pas pour commenter le réel, mais souvent pour le bousculer. Se l’approprier avec un autre regard.
La forme même du “1” permet de prendre du recul. C’est avant tout un objet graphique qui se déplie comme un origami. Qui ne ressemble pas aux standards de la presse. Pas de photos, là aussi pour ne pas alimenter la confusion avec la réalité, mais des illustrations… et des poèmes. Un seul sujet, une seule feuille de papier… une heure de lecture.
Un journal d’inspiration pour lire des mots qui entrent en résonance avec chacun. Des mots qui créent du lien et non du clivage ou de la polémique. Dans le premier numéro du “1”, en avril 2014, J.M.G. Le Clézio parlait du rêve et de la France. “J’ai grandi dans un pays imaginaire. Je ne savais pas qu’il l’était à ce point. […] Pourquoi mes rêves ne seraient-ils pas vos rêves ?”
Beaucoup aujourd’hui ont besoin de partager et de vivre une chose commune. Beaucoup ont besoins d’histoires pour se sentir debout dans un monde difficile… pour rêver ensemble.

Likes destructeurs
Tous les matins en allant bosser à vélo, Patrik Svedberg longeait le lac Vättern (sud de la Suède). Il passait devant un gros arbre qui ressemblait à ce qu’il détestait manger depuis son enfance, des brocolis.
Donc tous les matins, ce photographe se disait qu’il passait devant le “Broccoli Tree”. Et puis un jour, c’était au printemps 2013, il s’est arrêté et a pris un cliché. Arrivé à l’agence photo, il a posté l’image sur son compte Instagram. Les matins suivants, Patrik Svedberg a fait d’autres photos, qu’il a continué à partager sur le réseau social. Le ciel changeait, les feuilles poussaient. Les likes ont afflué.
En avril 2014, le photographe a ouvert un compte Instagram consacré au Broccoli Tree. Une page Facebook dédiée a suivi. L’arbre sous la pluie. L’arbre avec un oiseau qui vole au-dessus. L’arbre sans feuilles l’hiver. Et toujours plus de likes.
Les gens des environs sont venus pique-niquer vers l’arbre, d’autres faire leur jogging. La vie locale s’est organisée autour du Broccoli Tree. Tous les matins, en arrivant à l’agence, Patrik constatait que les abonnés étaient toujours plus nombreux. Jusqu’à 30 000 followers sur Instagram.
Ça lui faisait du bien de se dire qu’il y avait ce rendez-vous régulier avec tant de gens sensibles à l’arbre. Les likes venaient comme des encouragements pour la journée. À l’été 2015, Patrik a organisé une exposition de ses photos au pied du Broccoli Tree. Succès. Il a même lancé l’édition d’un calendrier.
Un jour, quand il s’est arrêté devant l’arbre, il y avait un combi Volkswagen et cinq motos. Les gens s’étaient renseignés et ses photos faisaient venir des curieux de beaucoup plus loin. Google Maps avait référencé The Broccoli Tree comme lieu d’intérêt touristique. On trouvait maintenant la balise de localisation sur la carte de cette région de Suède. Patrik a posté un commentaire : “Waouh, tellement content de pouvoir partager quelques instants avec vous sous ce bel arbre !”
Mais le lendemain, vers 8 h 20, il a découvert des initiales entaillées dans l’écorce de l’arbre. Il a repris son vélo, inquiet. En se retournant, il y avait deux ados qui sautaient en l’air pour attraper des feuilles. Quelque chose d’incontrôlable était en marche. Et puis en fin de semaine, la blessure.
Dans la nuit, des dingues avaient eu la mauvaise idée de scier une branche, sans pouvoir l’emporter comme un trophée. Alors bien sûr que Patrik a fait une photo en ajoutant un commentaire : “Des abrutis ont scié une branche il y a deux ou trois jours, elle tient à peine et finira par tomber. […] Le problème, c’est qu’on ne peut pas dé-scier un arbre.”
Le coup de grâce est arrivé deux mois plus tard. La branche estropiée avait pourri et l’arbre menaçait de s’effondrer. Les services municipaux se sont déplacés pour le couper, ne laissant que les troncs. À la fin de l’année 2017, soit quatre ans et demi après la première photo, les likes avaient eu raison de l’arbre que Patrik avait découvert.
Depuis, chaque matin, il ne longe plus les bords du lac, il fait un détour plus au nord pour rejoindre l’agence. Il vient de créer un compte Instagram où le week-end, il poste des photos de carottes bio achetées au marché. Sa mère préparait une incroyable purée de carotte. Il a déjà plus de 3 000 abonnés.

Le tee-shirt de Mark Zuckerberg
Régis est arrivé ce matin à l’agence et sans même prendre le temps de quitter sa veste, il a demandé : « Vous savez pourquoi Mark Zuckerberg porte toujours le même tee-shirt gris ? » Et là, silence.
Tout le monde a pensé : « Pas cool Régis en ce moment, il faut vraiment qu’on trouve un moment ce soir pour aller boire une bière. » On n’a pas bien compris tout de suite, mais la question a trotté dans la tête de chacun, toute la journée. C’est vrai ça, pourquoi le même tee-shirt gris ?
Le patron de Facebook s’en est expliqué souvent. En gros, il doit s’occuper de plus de deux milliards d’utilisateurs Facebook, et n’a donc pas trop de temps à consacrer à ce qu’il va manger à midi ou ce qu’il va porter chaque matin. Cela dit, que les choses soient claires, il ne s’agit pas du même tee-shirt qu’il laverait le soir pour le remettre le lendemain, non, il dispose d’une multitude du même tee-shirt. Gris. Le même…
On l’imagine bien Mark, prendre son téléphone en début d’année pour commander cinq cartons de tee-shirts gris. « Oui, bonjour, oui, comment ? oui, effectivement… bon écoutez, moi je dois veiller sur deux milliards de personnes, donc, si vous avez en stock 850 tee-shirts gris tous pareils, vous me livrez ça dans deux jours à Menlo Park.
C’est comme le sous-pull noir à col roulé, jeans Levi’s 501, baskets New Balance de Steve Jobs. Steve, c’était pareil, pour rien au monde il n’aurait changé de tenue… et pourtant, pas cool l’été, le col roulé. Il avait contacté Issey Miyake, le célèbre styliste japonais, créateur dans les années 1980, d’un uniforme pour les salariés de Sony. Et Issey lui avait fait plusieurs propositions de sous-pull noir pour qu’il puisse choisir. Steve en avait retenu un et Issey lui avait préparé une centaine de polo noir qu’il avait empilés soigneusement. « Cool man, j’en ai juste assez pour le reste de ma vie.».
Et les costumes tous identiques de Barack Obama. « Je ne porte que des costumes bleus ou gris, j’essaie de réduire au maximum le nombre de décisions à prendre sur des sujets insignifiants. Je ne veux pas en prendre en rapport avec ce que je porte ou ce que je mange, parce que j’en ai trop à prendre par ailleurs avec des enjeux importants. Vous devez mettre en place une routine, vous ne devez pas être distrait par des choses triviales pendant votre journée. »
Et c’est là qu’on découvre que passer trop de temps à prendre des décisions inutiles entrave la performance. En gros, ne perdez pas de temps à choisir votre menu de midi, contentez-vous d’un tee-shirt gris et vous deviendrez un winner.

Le Post-it Apple
Non, mais c’est quoi tous ces mecs qui se baladent dans l’Apple Park avec un sparadrap sur le nez ou sur le front ? Ça fait pas très design minimaliste, tout ça. Ils ont ouvert une salle de boxe chez Apple ?
Là, on est à Cupertino en Californie, au nouveau méga-siège social d’Apple, qui a été inauguré en avril dernier. Une soucoupe, un anneau de verre de 260 000 mètres carrés, dessiné par l’architecte britannique Norman Foster. L’esprit Apple à la taille d’une mini-ville installée sur 70 hectares. Steve Jobs l’avait imaginé, il y a sept ans, comme “une ode à l’ouverture et à la liberté de mouvement”. Même logique, même soin particulier apporté au design intérieur et aux matériaux de cet écrin de transparence, où la lumière est traversante partout.
C’est quelque 13 000 personnes qui bossent dans ce temple futuriste de la Silicon Valley, à la gloire de la marque à la pomme. Et donc les mecs avec des sparadraps, on ne comprend pas, ça fait désordre. Il y en aurait même certains qui se seraient retrouvés aux urgences !
Sauf que l’architecture de verre, la transparence à tous les étages, quand tu as les yeux rivés sur l’écran de ton MacBook Pro, iPad ou iPhone, c’est vite un poil dangereux. Quand tu cours pour te rendre à l’autre bout de l’anneau, à une réunion qui commence dans cinq minutes, c’est un peu comme quand tu t’es gouré de terminal à l’aéroport de Roissy : tu te cognes dans tout. Sauf que là, chez Apple, tu te prends la porte en verre ou la paroi vitrée, et tu t’ouvres l’arcade sourcilière.
Rapidement, pour éviter les plaies et les bosses, certains collaborateurs ont décidé de coller des Post-it pour indiquer la présence des panneaux de verre. Sans rien demander à Norman Foster… Genre, tu transformes une cathédrale de lumière en tableau de brainstorming.
Les hauts responsables d’Apple, ils ont pas trouvé ça génial, comme idée. “On n’a pas dépensé 5 milliards de dollars (ah oui, quand même !) pour se retrouver avec des Post-it partout. Non, mais les mecs, c’est l’esprit de Steve que vous profanez, à chaque Post-it que vous collez sur une surface immaculée. C’est comme si vous lui donniez une baffe dans la gueule… Faut réfléchir, les mecs. Respect, quoi !”
Dans les années 1980, Steve Jobs avait envisagé de faire porter à tous les employés Apple un uniforme gris dessiné par Issey Miyake, et ça n’avait pas pris. Tout le monde avait détesté l’idée ! Mais là, on est confiant que cette fois-ci, les designers vont concevoir, dans l’esprit de la marque à la pomme, un super beau protège-front que chacun pourra porter pour déambuler sans risque dans l’écrin de lumière imaginé par Steve.
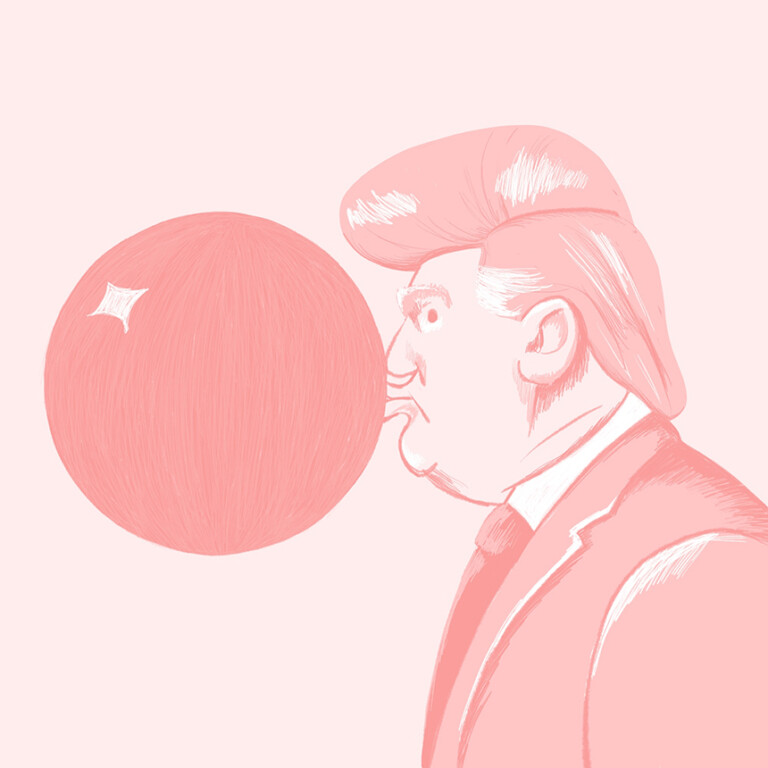
La vérité élastique de Trump
Un an de Trump à la Maison-Blanche et l’on commence à comprendre que la vérité est maintenant considérée comme une idée à géométrie variable. Que la vérité est quelque chose qui est plus proche d’un élastique qui se tend et se transforme comme un Barbapapa, que d’un cristal intouchable.
En 1987, dans son livre The Art of the Deal, Donald Trump, alors homme d’affaires flamboyant, avait déjà développé le concept d’« hyperbole véridique ». Et quelle meilleure illustration que la Trump Tower ! On est en 1979 et les architectes dévoilent au fringant Donald Trump (il a 33 ans), la maquette de son projet immobilier new-yorkais, la Trump Tower au cœur de Manhattan, sur la prestigieuse Cinquième Avenue, juste à côté du célèbre joaillier Tiffany. Le futur président est pris de furie et explose : « Mais c’est quoi, cette putain de tour qui est plus grande que la mienne ? ». À quelques blocs d’immeubles du futur chantier, le General Motors Building, du haut de ses 214 mètres, mesure 12 mètres de plus que la future Trump Tower. Et déjà en germe, le Trump avec son gros bouton qui ne supporte pas qu’un autre en ait un plus gros que le sien…
Il se retourne vers les architectes. Comment faire pour que SA tour soit la plus grande du quartier, alors qu’il n’est bien évidemment pas question de construire des étages supplémentaires ? Les architectes se regardent, médusés, ne voyant pas bien ce qu’ils peuvent faire. « Vous n’avez aucune imagination, c’est affligeant, mais c’est pourtant très simple ! » Trump décrète que les premiers appartements situés au-dessus des 19 premiers étages comprenant un gigantesque atrium et des galeries marchandes, n’ont aucune bonne raison de s’appeler « 20e étage ». « Oui, finalement pourquoi ? » Il va donc les nommer « 30e étage ». Le dernier niveau de sa tour de 58 étages s’appellera désormais « 68e étage ». C’est là que trump lui-même habite dans un triplex de 3 000 m2. Le General Motors Building et ses 50 « petits » étages est, d’un coup, complètement ridiculisé.
Trump a étiré la réalité sans réellement mentir, à tel point que les autres promoteurs immobiliers vont le copier. Cela est même devenu une nouvelle façon d’afficher sa puissance à New York. Par exemple, le Time Warner Center, achevé en 2004, se vante d’avoir 80 étages, alors qu’en fait, il n’en a que 69. Trump avait déjà repris la même logique pour sa Trump World Tower inaugurée en 2001, presque en face du siège des Nations Unies. L’édifice de 262 mètres est annoncé à 90 étages… et il n’en compte que 72.
Règle de base, donc, prendre la réalité et tirer dessus jusqu’à ce que cela corresponde à ce que vous souhaitez. « Comment osez-vous parler de mensonge, alors qu’il ne s’agit que d’hyperbole ? » En 2016, un illuminé se mit en tête d’escalader la Trump Tower pour porter un message à Donald Trump. Il a été arrêté par la police au 31e étage. « Comment ça, 31 ? Mais je n’ai escaladé que 21 étages ! »

La vague
On vient de vivre une séquence « catastrophe naturelle » qui nous a ouvert les yeux sur la réalité. En gros, le schéma est simple. Nos sociétés occidentales ont connu un bouleversement historique avec la révolution industrielle du XIXe siècle. On a produit de plus en plus, on a pollué de plus en plus, et puis tout s’est accéléré avec le néo-libéralisme des années 80. Les années Thatcher et Reagan.
Capitalisme industriel, capitalisme financier et changement climatique. Tout est lié, il faut le dire et le redire. Le capitalisme détruit la planète. En 2014, c’est Naomi Klein, la journaliste canadienne qui piquait un gros coup de gueule avec son livre « Tout peut changer : capitalisme & changement climatique » (This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate).
Naomi Klein, c’est le livre No Logo, sur la tyrannie des marques dans nos sociétés où le marketing dicte tout. Comment les grandes marques font travailler les pays les plus pauvres de la planète. On découvrait que le coût de production d’un jean que l’on trouve dans nos boutiques tendance à Paris, c’est à peine 10 % (dont 3 % de main d’oeuvre), 5 % pour le transport en bateau du bout du monde, 40 %, c’est la marge de la marque (pub incluse), 45 %, celle du détaillant.
On découvrait aussi comment une forme de résistance se mettait en place avec l’altermondialisme. Une nouvelle consommation possible. « Tout peut changer ». Et l’on est tombé par hasard sur une analyse de la documentariste et activiste Astra Taylor qui s’arrête sur le livre de Naomi Klein, sur la façon dont le changement climatique ne peut être arrêté que par une refonte du capitalisme. Avec une illustration d’une évidence à couper le souffle. Elle est signée Sébastien Thibault, un dessinateur de presse canadien qui travaille pour de nombreux médias internationaux The New York Times, Time Magazine, The Guardian, Neue Zürcher Zeitung, The Washington Post, Wired ou encore L’Obs.
Une simple vague, immense qui va tout détruire si l’on ne bouge pas. Là, la grosse cheminée qui fume, on est bien tenté de mettre une grosse croix rouge dessus.

Encore Uber
C’est quand même la classe de voir arriver au bout de la rue, une élégante berline noire. La voiture s’arrête lentement et le chauffeur descend pour vous ouvrir la portière arrière. « Bonjour Monsieur, bonjour Madame bienvenue chez Uber… si vous le souhaitez, vous avez une bouteille d’eau devant vous. » La classe.
Évidemment, on est étonné la première fois, tellement on a été mal traité, mal accueilli dans les taxis parisiens. La fenêtre ouverte alors qu’il fait froid, “Les Grosses têtes” et leurs blagues pas forcément à notre goût.
Quand vous montez dans un Uber, c’est comme quand vous rentrez dans la boutique Nespresso à Opéra, ou le flagship Louis Vuitton sur les Champs-Elysées… sitôt passé la porte, vous êtes quelqu’un d’important à qui on parle avec douceur et attention. C’est comme cela que l’on vous voit et cela fait un bien fou.
Alors oui, la première fois chez Uber, on est scotché. Genre L’Oréal « Parce que je le vaux bien ! » Quand même… « Avez-vous une station de radio préférée ? »
La première fois, on se sent effectivement quelqu’un d’important. La deuxième fois, comment dire… on revoit la même voiture ou presque, le même chauffeur, du moins habillé pareil, et le même « Bonjour Monsieur, Madame, bienvenue chez Uber… ».
Et là, on se dit que ce qui était bluffant la première fois, l’est beaucoup moins les fois suivantes. Que ce que l’on avait pris pour de l’attention personnalisée n’est finalement qu’une suite d’éléments de langage standardisés. Et ça en devient même désagréable, de distance et de faux-semblant.
« On ne s’adresse pas à moi, on s’adresse à un client lambda qui a été défini par le marketing de Uber. » Et l’on en vient à regretter le chauffeur de taxi caractériel qui vous déstabilise par ses questions indiscrètes ou ses commentaires déplacés.
C’est peut-être les limites du décor Uber, de sentir que malgré les apparences du luxe, vous n’avez accès, qu’à une forme édulcorée qui se résume à la couleur d’une voiture, une veste Armani et une bouteille d’eau fraîche.
Mais ça marche, car à chaque fois le « Bonjour Monsieur, bienvenue chez Uber… » agit comme un baume bienveillant.

Des pare-brise propres
C’est en s’arrêtant l’été dernier sur une aire d’autoroute, que l’on avait remarqué ce détail. On avait roulé durant plus de quatre heures et on allait faire une pause pour le carburant.
– Et tu veux que je te passe un coup sur le pare-brise ?
– Non, non, c’est bon, il n’est pas sale… Par contre, je boirais bien un soda, il fait une de ces chaleurs !
Et de regarder le pare-brise en attendant le rafraîchissement. Les moustiques décédant par tombereaux entiers, les sauterelles bien nourries qui laissaient un jus verdâtre sur la carrosserie, les gros hannetons qui nous faisaient sursauter à chaque fois qu’il y en avait un qui frappait la vitre. Même que l’on croyait que c’était des impacts de pierre… Toutes ces bestioles qui salopaient gentiment la bagnole, c’en est fini.
Il n’y a plus d’insectes écrasés sur la vitre des voitures comme c’était le cas, il y a encore vingt ans. Alors, on s’était dit que peut-être que les insectes étaient plus rapides aujourd’hui qu’avant, pour éviter les voitures. Ou encore que les voitures sont aujourd’hui mieux profilées, plus aérodynamiques, qu’elles se glissent dans l’air sans qu’un insecte arrive à toucher la tôle.
En fait, non… c’est que des insectes, il n’y en a pratiquement plus. Les voitures sortent du péage après six heures d’autoroute comme du Car Wash. Plus une trace de diptères, de lépidoptères ou autres coléoptères sur les carrosseries. Études scientifiques à l’appui, en Europe, 75 à 80 % des insectes ont disparu depuis trente ans. Aux États-Unis, pour la seule année 2016, c’est 30 % des abeilles qui sont mortes. Des chiffres qui surpassent de loin celui du déclin des vertébrés, estimé à seulement 58 % depuis les années 1970.
Mais qu’est-ce qui se passe et quelle est la cause de ce massacre en règle ? Les entomologistes restent prudents. On n’est pas sûr mais… comment dire, on pense vraiment que c’est dû à l’intensification des pratiques agricoles et au recours aux pesticides. Pour une fois qu’on n’explique pas une hécatombe par le réchauffement climatique qui devrait plutôt encourager la prolifération des insectes, et non leur diminution.
Par contre, ce qu’on redoute, c’est l’effet en cascade, l’effet domino. Les insectes jouent un rôle majeur dans la pollinisation de 80 % des plantes sauvages, sans parler des oiseaux qui se retrouvent avec moins à manger. Le gros problème, c’est que l’on se sent tous concernés par les abeilles et le miel sur les tartines. Et beaucoup moins par toutes les petites bestioles à six pattes qui ne salissent plus nos voitures.

De la neige dans les yaourts ?
JO d’hiver 2018 à Pyeongchang, en Corée du Sud et tout le monde constate que les tribunes sont désespérément vides devant la descente hommes qui est normalement la discipline reine des Jeux olympiques d’hiver.
“Il n’y a personne, c’est vraiment ridicule... Entre le ski alpin et les Coréens, l’incompréhension est presque totale”, juge le journal L’Équipe. Faut dire que les tarifs sont exorbitants (400 € la place pour la finale dames de short track), qu’il fait très froid, jusqu’à - 20°C pour certaines épreuves. Mais alors, ils sont où les Coréens, s’ils ne sont pas au bord des pistes ?
Et là, on tombe sur le “mukbang”. Rien à voir avec une nouvelle discipline olympique. Pas besoin de se geler sur les sommets enneigés, il suffit de se caler devant son écran d’ordinateur pour regarder une vidéo. On y découvre une jeune fille, qui aligne une quarantaine de pots de yaourt devant elle. Elle ouvre le premier et enchaîne les coups de cuillère à un rythme régulier, tout en dialoguant avec des internautes curieux d’en savoir plus sur elle. Au bout d’une demi-heure, la fille se lève, disparaît quelques instants et revient avec trente nouveaux pots de yaourt, qu’elle va ingurgiter avec la même régularité.
Depuis plus de trois ans, le “mukbang” (“manger en ligne” en coréen) explose sur les écrans internet en Corée du Sud. Les “mangeurs” (plus de 15 000 individus) commencent généralement à se filmer, parce qu’ils se sentent seuls. Et de l’autre côté, les “voyeurs” (plus de 500 000 par jour) se sentent un peu moins seuls. Ils ont l’impression de dîner “en famille”, en suivant presque religieusement Shoogi, 20 ans, par exemple, qui se bâfre de poulet frit puis engouffre deux plats énormes de tteokbokki, des gâteaux de riz baignant dans de la sauce épicée. Résultat, banco ! Plus d’un million de vues sur YouTube. Certains “mangeurs” en font un véritable business, via les dons des spectateurs ou le recours à des sponsors.
Autre vedette du moment, un vrai champion élevé au grain, c’est Benzz qui affiche plus de 150 millions de vues avec près de 500 000 abonnés. C’est tous les jours que l’athlétique jeune homme publie une vidéo, où on le voit se goinfrer avec une montagne de gâteaux à la crème, accompagnés de plusieurs briques de lait. “À chacun son talent ! Moi, j’ai une excellente digestion. Je peux manger énormément sans problème !”
Dans une société ultra-compétitive où le stress est partout, les Coréens sont en permanence sous tension. Le devoir de réussite et l’obsession de l’excellence, la peur de l’échec, la frustration… tout le monde est au bord du pétage de plombs. Pour eux, suivre les JO, c’est retomber dans la performance et la compétition. Alors que de regarder des vidéos de “mukbang”, c’est carrément de la méditation, de l’anti-stress en crème pâtissière. Du divertissement quotidien en blancs de poulet frit. “À la place de l’épreuve de saut à ski, le jeune Patoo, 16 ans, lui, ça fait trois jours qu’il s’empiffre de nouilles avec du bœuf au soja, j’adore ça !”

Cheveux au vent !
C’est un geste anodin, mais qui raconte beaucoup.
C’est Marlène Schiappa, la secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes et les hommes qui l’a confié entre deux interventions gouvernementales : “Je m’attache aujourd’hui les cheveux pour qu’on écoute ce que je dis.” Oui, c’est vrai que l’on commente beaucoup les cheveux de Marlène Schiappa. Comme s’il était difficile d’être attentif aux paroles d’une femme politique, sans être troublé par son apparence.
Et l’on repense à toutes les femmes ministres. Depuis des années, depuis toujours, toutes ont porté les cheveux courts ou les cheveux attachés, à l’image de Simone Veil. “Il y a un livre à écrire sur les cheveux en politique”, poursuit Marlène Schiappa.
L’image la montrant cheveux au vent sur le perron de Matignon, c’est terminé. Elle a vite compris que ça ne passait pas. On fustige l’Iran et le voile imposé aux femmes, mais on ne supporte pas une femme politique qui se passe la main dans sa chevelure. Alors bien sûr qu’on ne lui demande pas frontalement de mettre de l’ordre dans sa coiffure, mais la femme politique comprend vite que ses mots porteront davantage, dès lors qu’elle aura les cheveux attachés.
Marlène Schiappa a aussi renoncé aux bracelets. Le vernis rouge, sur ses ongles, elle ne l’a pas enlevé. Elle en a juste un peu marre que l’on parle de son look et pas de son action ni de ses engagements. Un aveu d’impuissance face à une société qui ne peut pas s’empêcher de stigmatiser les signes extérieurs de féminité chez les politiques…
Juillet 2012, à l’Assemblée nationale. Une robe trop fleurie provoque le trouble des députés mâles. Et l’on entend des caquètements, des gloussements, des sifflets, des bruits de poule… quand Cécile Duflot, alors ministre du Logement, s’apprête à prendre la parole.
Les cheveux au vent, la robe fleurie. Et Marlène Schiappa de revenir sur un autre détail. La “mauvaise habitude” de désigner les femmes politiques simplement par leur prénom. Un exemple de sexisme gentiment ordinaire. Un ministre répond à un journaliste, il parle de Castaner, de Bruno Lemaire… et de Marlène… la bonne copine, qui a juste un prénom. Tellement sympa, Marlène !
Vous avez tout vu !
Une petite erreur au chargement