
Pauses by Noise
Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

Je te google, tu me googles, nous nous googlons…
C’était un matin de septembre, à la radio, un anniversaire que l’on n’a pas vu venir… et oui, Google a 20 ans.
Au départ il s’agissait de se repérer au milieu du réseau naissant. « Non mais, je fais comment pour trouver une information au milieu de tout ce bordel ? ». Deux étudiants de l’université de Stanford aux États-Unis, Sergueï Brin et Larry Page vont partir de la littérature scientifique où un article est valorisé proportionnellement au nombre de publications qui le citent.
En quelques mois, ils développent un algorithme qui pointe les liens. Pendant 10 ans, Google sera un moteur de recherche rapide, astucieux et efficace, mais sans plus. Comme Yahoo, Lycos, Altavista, GoTo ou Excite.
En 1998, on est à 10 000 requêtes par jours. Août 1999, on passe la barre des 3 millions de requêtes/jour… 20 ans plus tard, en 2018, c’est 3,3 milliards de requêtes/jour.
La vraie bascule a lieu en 2001. L’idée géniale des deux créateurs de Google, qui va faire la différence avec les autres moteurs de recherche qui placardent des grandes bannières publicitaires en tête de site… c’est de vendre l’insertion de petites publicités au format texte, dont le contenu est directement lié à la recherche de l’internaute. C’est plus rapide à charger, le design est plus neutre donc ça ressemble à quelque chose de plus objectif. Et là, en quelques mois, les résultats financiers de Google écrasent la concurrence. Méthodiquement, le rouleau compresseur va étendre son terrain d’action.
2001, quelques jours après le 11 septembre, c’est la sortie de Google News, l’information en ligne. Et là, panique dans les supports presse où le vent du boulet commence à se faire sentir fortement.
À marche forcée, Google avance.
En 2004, c’est Google Book Search qui archive des millions de livres, rendus ainsi accessibles au public. Le droit d’auteur est balayé. La même année c’est Gmail puis le rachat de Earth Viewer renommé un an plus tard Google Earth. En 2005, c’est la mise à disposition de Google Maps et la démocratisation du GPS qui l’accompagne. En 2006, c’est au tour de la musique et du cinéma, de trembler avec le rachat de Youtube. En 2008, c’est Chrome qui marche sur les platebandes d’Explorer (Microsoft) et Safari (Apple). Enfin, en 2011 c’est Google Drive.
20 ans plus tard, l’empire effraie jusqu’aux gouvernements. C’est une entreprise dont la capitalisation frôle les 750 milliards… c’est colossal.
C’est plus que le PIB de la Belgique ou de l’Afrique du Sud. C’est plus de 90% de part de marché. C’est tellement énorme, que c’est devenu un geste familier, banal, de tout « googler ».
C’est devenu un verbe. Une réponse à tout, ou plutôt plusieurs millions de réponses en 0,38 seconde. En 20 ans, Google a réussi à ce que chacun intègre cette fonction. Au point que l’on questionne Google avant même de poser la question à ses parents, à ses amis.
Requête : « C’est normal d’être stressé le lundi matin ? » 8 920 000 résultats (0,52 secondes).
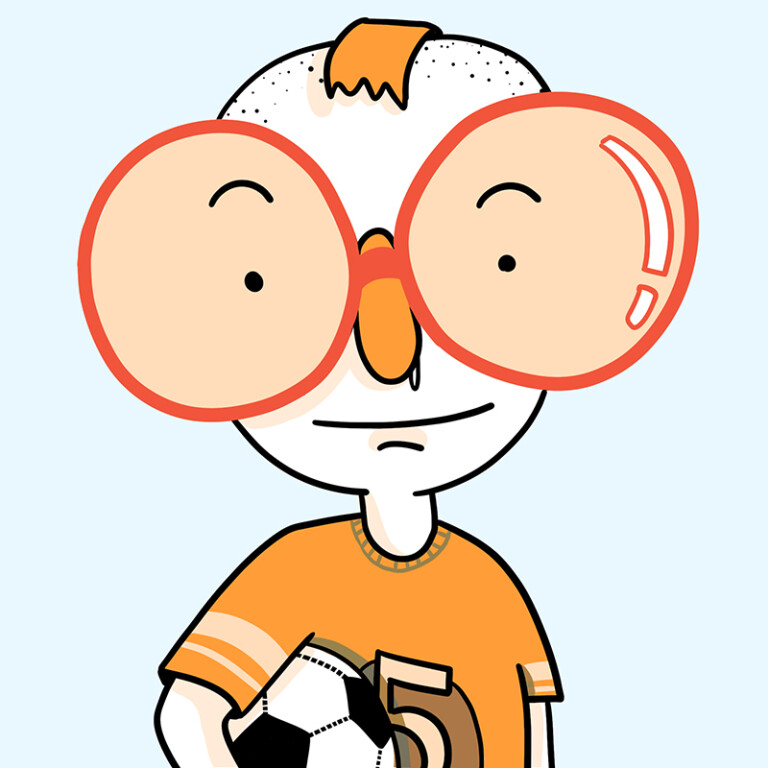
"Va dehors, tu verras loin !"
“Tu discutes pas, tu vas dehors… J’ai pas envie que tu deviennes myope. Allez, va prendre l’air !” On tombe là-dessus par hasard. La myopie, c’est une personne sur trois en Europe et près de la moitié des 25-30 ans qui en sont atteints.
Et c’est bizarrement deux fois plus que dans les années 1970. Alors on se dit : “Mais qu’est-ce qui s’est passé en cinquante ans pour que les mômes deviennent tous flous ?”
On a, bien évidemment, fait reporter la faute sur les écrans d’ordinateur et les jeux vidéo. “Bon là, faut vraiment arrêter de jouer à Pokémon, tu poses ta DS et tu prends un livre… Comment ? Non, pas un manga !”
Sauf qu’aucune étude scientifique n’a jamais démontré la relation de cause à effet. Alors, c’est quoi ? En fin de compte, ça serait beaucoup plus simple que ça… La myopie serait liée à notre exposition à la lumière naturelle.
La lumière agit sur la diffusion de dopamine qui a un impact direct sur la croissance de l’œil. La myopie, c’est un œil qui se développe trop. La diffusion de dopamine permettrait justement de limiter la croissance du globe oculaire.
Depuis cinquante ans, notre façon de vivre a évolué. Les enfants et les adolescents restent plus facilement à l’intérieur des appartements, ils pratiquent moins de loisirs dehors et sont donc moins exposés à la lumière.
Un autre élément est à prendre en compte dans le développement de la myopie : le fait qu’à l’extérieur, les enfants concentrent leur regard sur des objets plus éloignés qu’à l’intérieur. En focalisant des distances différentes, l’œil n’arrête pas de faire une gymnastique de mise au point qui limite, là encore, la myopie.
Et l’on revient quand même aux écrans d’ordinateur ou de jeux vidéo, où l’œil est très proche de ce qu’il regarde. En jouant ou en passant plus de temps à l’extérieur, l’enfant reçoit plus de lumière et fait travailler en permanence ses yeux.
Autre conséquence de la vision rapprochée, l’enfant qui lit trois livres par semaine a plus de chances de développer une myopie que celui qui tape dans un ballon pendant des heures, en rentrant de l’école. Ou alors, il faut lire dehors et pas allongé sur son lit !
“C’est vrai ça, t’as déjà vu un joueur de foot avec des lunettes ? Eh non ! Pas de lecture de près (ni de loin). Ni Flaubert ni Musso. Du matin au soir à l’extérieur, le footeux court après un ballon qui rebondit comme une puce d’eau. L’oeil travaille autant que les cuisses. Tout ça en se gavant de bonne lumière du jour. Résultat, pas de myopes sur les terrains de foot.”

Chacun sa petite histoire
La grosse claque, quand on découvre ce week-end, dans la vitrine du bouquiniste de la rue Oberkampf, un disque que l’on n’avait pas revu depuis 1981 ! “Remain in Light” des Talking Heads.
Plus de trente-cinq ans après, on reste scotché, médusé, là, sur le trottoir. Alors bien sûr, on entre et on prend le disque à pleines mains. On le retourne, on le sort de sa pochette, vieux réflexe de l’époque où l’on regardait toujours la qualité du vinyle.
Et là, bien évidemment que l’on va l’acheter. À 8 euros, il n’y a pas à hésiter. On ne pense même pas qu’on n’a plus rien comme matériel pour l’écouter. Plus de platine disque, d’ampli ni d’enceinte.
On avait adoré, complètement adoré ce disque ! Faut dire qu’à vingt ans, quand tu es aux Beaux-Arts et que tu achètes un disque qui explose tous tes sens… C’est largement plus excitant qu’une Rolex à 50 ans. Là, c’était le monde qui s’ouvrait, genre Moïse dans les Dix Commandements.
Une putain de pochette. Incroyable d’imaginer ça en 1981, ces quatre visages rouges bidouillés numériquement comme des masques. On apprendra plus tard, bien plus tard, que c’était le graphiste américain Tibor Kalman qui avait créé la pochette.
Et puis la musique. Des rythmes africains funky, un mélange de styles dans tous les sens et de l’invitation à bouger. Ça se prend pas au sérieux et pourtant c’est super bien calé. Brian Eno aux commandes. On avait l’impression de voir le monde autrement. De découvrir…
Alors oui, bien évidemment qu’on achète le disque. On rentre chez soi et on se précipite sur YouTube pour écouter “Remain in Light”… faut bien l’écouter quand même. Et là, on se dit que c’est quand même étrange ce besoin que l’on à partir d’un certain âge de retrouver, d’acheter ce qui a bercé notre jeunesse.
On l’avait senti venir vers la quarantaine. C’était il y a plus de dix ans, en regardant “State of Play”, une série britannique diffusée par BBC One. Une scène en particulier. La femme d’un politicien britannique interpelle un journaliste après avoir regardé sa bibliothèque de CD. “C’est étonnant : passé un certain âge, on ne retrouve que des compilations sur les étagères. c’est comme si les mecs ne voulaient pas prendre de risques après 40 ans.”
Passé 40 ans, on a tous plus ou moins le sentiment que notre petite histoire, unique, personnelle, n’est faite que de souvenirs. Des centaines, des milliers de petites choses qui vont mourir avec nous. Que l’on ne peut pas préserver.
Alors, on va commencer à retrouver des éléments de cette petite histoire. Un meuble, une lampe, un livre, un disque. Comme si l’on reconstruisait ce qui pourrait ressembler à un mini-musée personnel. Pour que la petite histoire raccroche à la Grande !

Des branches dans le ciel
Pause de l’été. Où l’on recherche de l’ombre pour s’allonger sous un arbre. Et l’on ne va pas faire plus que ça. On va se contenter de la lumière filtrée par le feuillage d’un tilleul.
S’allonger dans l’herbe. On ne pense à rien d’autre et on regarde les branches, les feuilles au-dessus de soi. Le tronc de l’arbre, les branches. Et là, aller savoir pourquoi, une idée revient, un truc lu entre la “Vierge aux rochers” et le “Saint Jean-Baptiste” et son doigt d’honneur.
Une anecdote à propos de Léonard de Vinci. Pas le vautour que Freud a cru entrevoir, à propos de “La Vierge, l’enfant Jésus et sainte Anne”. Trop connu le coup de la fellation subliminale… Non, un truc simple mais que personne n’avait remarqué avant Léonard et que l’on n’a pas su expliquer depuis.
Juste là, étendu dans l’herbe, sous un arbre. Et là, comme Léonard à la Renaissance, on regarde le tronc et les branches. Juste ça… Et tu remarques un détail… un arbre pousse presque toujours de la même façon… et presque toujours, l’épaisseur totale des branches à une hauteur donnée est égale à l’épaisseur du tronc. C’est tout !
C’est pas compliqué, mais ça nous bluffe. Des millions de gens ont vécu dans les forêts, au milieu des arbres et il fallut qu’un peintre, un artiste, un penseur, un ingénieur avant la lettre, s’allonge sous un arbre, pour voir ce que personne n’avait vu.
En quelques minutes, Léonard va établir une règle qui deviendra quasi mathématique et qui annonce les fractales de Mandelbrot. Lorsque le tronc d’un arbre se divise en deux branches, la section totale de ces branches secondaires sera égale à la section transversale du tronc. Si ces deux branches se divisent à leur tour en deux branches, la zone des sections des quatre branches supplémentaires sera égale à la superficie de la section transversale du tronc. Et ainsi de suite, un enchaînement sans fin. Et ça nous emmène dans des abîmes de feuillage.
On est toujours allongé et l’on se dit que c’est incroyable, la nature. Et rien que d’y penser, ça va nous occuper tout l’été. Maintenant on va fermer les yeux et entamer une sieste réparatrice… on verra plus tard pour une deuxième idée fulgurante. Là, allongé sous le tilleul, on se dit que l’on est vraiment bien.

Le retour des Treets
“Ça fond dans la bouche, pas dans la main.” On avait un vague souvenir d’avoir entendu cette pub à la fin des années 1970. Et puis plus rien. Un beau jour de 1986, on n’a plus trouvé de Treets dans les présentoirs. Sans trop savoir pourquoi.
Nés en 1955, les célèbres Treets, c’étaient trois composantes terriblement efficaces. Des cacahuètes enrobées de chocolat, un paquet jaune, et un slogan. À l’époque de leur disparition, on avait parlé du propriétaire de la marque, l’Américain Mars, qui ne souhaitait pas faire d’ombre à son produit phare M&M’s. Il avait donc enterré les Treets. Au point que l’an passé, il n’a pas renouvelé ses droits de propriété et la marque est tombée dans le domaine public.
Et là, ni une, ni deux, Lutti, le numéro 2 de la confiserie en France après Haribo, s’est engouffré dans la brèche pour racheter le nom et relancer les Treets en Europe. Trente ans après, tout est pareil : même logo, même produit, seul l’emballage est passé du jaune à l’orange, comme les TGV des années 1980. Une façon de s’éloigner du paquet de M&M’s et de ne pas être en concurrence frontale.
Changement d’époque. Le bonbon est devenu “responsable”, le paquet “recyclable” et le cacao, bien évidemment, issu du commerce équitable. Des mots qui sont devenus les mantras de notre temps.
Trente ans, c’est le temps nécessaire pour que la nostalgie joue à plein. Il faut que ça titille celui qui ado, volait un paquet au comptoir de la boulangerie. Car le consommateur visé est plus âgé que celui qui picore des M&M’s, plus âgé que la génération des écrans.
Lutti remet sur le marché un produit identique à un autre. Treets, c’est la même chose que M&M’s. Sauf que pour les nostalgiques, c’est pas du tout pareil. “Moi, le souvenir que j’en ai, c’est que les Treets, ils étaient plus gros. La cacahuète, oui, elle était plus grosse… et puis quand même, c’était pas le même goût, les Treets, ça sentait plus le chocolat.”
Les Treets, c’est le goût des années 1980 : Al Pacino dézinguant à tout va dans “Scarface”, le tube “Tainted Love” de Soft Cell, le goût du Chamonix orange ultra sucré, les premières disquettes souples 5,25 pouces de 360 ko… quand tu stockais l’équivalent d’un timbre poste sur ton PC, le Walkman de Sony… quand t’écoutais “Purple Rain” de Prince… en mangeant des Treets.
C’est un peu comme si l’on avait retrouvé les moules de fabrication des Treets et que l’on relançait la chaîne de production. “Allez les p’tits gars, on va s’y remettre, on va les sortir ces putains de bonbons que la génération smartphone n’a jamais fait fondre dans sa bouche. Et si vous bossez bien, avant le déjeuner, promis, vous aurez droit à un verre de Tang !”

Le silence de Birkenau
On se souvient du ton solennel d’André Malraux devant le catafalque noir dressé sur les marches du Panthéon. “Entre ici, Jean Moulin, une armée d’ombres t’accompagne… ”
On se souvient de mai 1981, un homme qui remonte la rue Soufflot, une rose à la main. L’espoir d’avoir 20 ans. La joie de voir la gauche au pouvoir. Et puis récemment, c’était quatre grands portraits de résistants accrochés aux colonnes. Quatre portraits dessinés par Ernest Pignon-Ernest.
Ce dimanche 1er juillet, c’est Simone Veil accompagnée de son mari Antoine qui entre au Panthéon. Neuf heures, il fait très beau ce matin dans les rues de Paris. La veille, les cris de joie ont accompagné l’équipe de France se surpassant en battant l’Argentine de Messi.
On arrive à l’entrée de la tribune des invités de la rue Cujas. Contrôle, fouille des sacs. Devant nous, “madame, vous n’avez pas d’invitation officielle” ! La femme âgée relève sa manche et montre le matricule tatoué sur son bras. “Ça va, ça ?” “Entrez Madame, désolé !”
Les personnalités arrivent. Les deux tribunes se remplissent. Il est 11 heures, la cérémonie commence. Et l’on entend la voix de Simone Veil. “Le Kadish sera dit sur ma tombe !” C’est le début de la remontée des deux cercueils vers le Panthéon. Remontée dans le temps. Les étapes importantes de la vie d’une femme qui aura été un acteur de l’histoire du XXe siècle.
La monté du fascisme, la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration… Simone Veil voulait travailler, être engagée. Elle deviendra magistrate, première femme magistrate. Première femme à être nommée secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature. Première femme ministre d’État et ce à la Santé. Elle présentera à l’Assemblée nationale la loi sur l’interruption volontaire de grossesse qui dépénalise l’avortement. Cette loi entrée en vigueur le 19 janvier 1975 porte, depuis, son nom.
Députée européenne. Première présidente du Parlement européen. Première femme membre du Conseil constitutionnel. En 2010, un sondage Ifop la présentait comme la “femme préférée des Français”.
Les deux cercueils sont déposés devant l’entrée du Panthéon. Emmanuel Macron est en tribune, il va prononcer un discours dense et émouvant. Une Marseillaise clôturera les mots du président, avec une anecdote bouclant sur l’histoire de la déportation de Simone Veil.
“Aujourd’hui, la France vous offre un autre chant, celui dont les prisonnières de Ravensbrück avaient brodé les premières paroles sur des ceintures de papier ; et qu’elles chantèrent le 14 juillet 1944 devant les S.S médusés. Ce chant que les déportés, chacun dans leur langue, entonnaient lorsque leur camp était enfin libéré, car ils le connaissaient tous par coeur. […]. Qu’il soit aujourd’hui, Madame, le chant de notre gratitude et de la reconnaissance de la nation que vous avez tant servie et qui vous a tant aimée. Ce chant, c’est la Marseillaise.”
Et puis, un moment inoubliable, d’une simplicité et d’une intensité incroyable. Une minute de silence du camp de Birkenau, là où fut internée Simone Veil en 1944-1945. Le 17 juin dernier, on a enregistré ce son, à 5 heures du matin. On y entend des insectes, on y entend le chant des oiseaux à l’aube. Le silence.

Roth, pas lu !
Plus de deux semaines après sa mort, Philip Roth est encore très présent dans les médias. Un hors série du “Monde”, qui le jour de sa disparition avait titré “Mort d’un géant”. “Le Un” qui consacre un numéro spécial. Mais il faut bien l’avouer : on n’a jamais rien lu de cet auteur américain, considéré comme l’un des monuments de la littérature contemporaine.
“Bon, donc on fait quoi quand on n’a rien lu de Roth ?” Oui, on passe pour une buse… et on fait profil bas, en mesurant l’abîme d’avoir fait l’impasse sur une légende vivante. Car lorsqu’on est cultivé, la question ne se pose même pas. Sauf que l’on ne vient pas de ce milieu, où la culture prend beaucoup de place… On vient d’un milieu, où il n’y avait pas de livres. Les livres sont venus plus tard.
On a commencé à lire, avec en tête cette blague de gosse : “Tu fais comment pour manger un éléphant ? Eh bien, tu le manges morceau par morceau.” Donc on lit tranquillement, livre après livre… sans se soucier de savoir si au bout du compte on aura lu tous les auteurs incontournables.
“Mais on doit obligatoirement parler d’un livre qu’on a lu… ou pas lu ?” Alors ça se fait, ça se fait même beaucoup… on lit aussi pour ça. Pour parler de ce que l’on a lu ! On lit pour poser des repères. Comme sur un plateau de jeu, on place ses références. Flaubert, Céline, Balzac, Hemingway… un peu comme une carte de visite ou un CV. L’intérêt des repères, c’est que tu passes facilement d’un auteur à l’autre, sans laisser de prise à la personne avec qui tu discutes.
Important, le contournement ! Car lorsqu’on n’a pas lu un livre, la personne avec laquelle on parle… ne l’a peut-être pas lu non plus ! Et c’est là où tu chausses des skis pour gentiment glisser vers Houellebecq ou Despentes que tu connais mieux.
Une star littéraire qui meurt, c’est des milliers de gens qui rentrent dans une librairie pour acheter ses romans.
— Il vous reste des livres de Philip Roth ?
— Non, désolé, mais là, depuis ce matin, depuis l’annonce de sa mort, c’est incroyable, j’ai tout vendu !
Donc, le mec, il est mort, et là on se dit, impatient : “Il faut que je lise aujourd’hui un de ses bouquins”, alors que la veille on n’y aurait même pas pensé. Et de redescendre sur Terre : “Hé mec, c’est Philip Roth qui est mort, c’est pas ses bouquins qu’on a détruits. Reste cool, continue comme avant, lis tranquillement les auteurs que tu aimes. Personne ne t’en voudra, si t’as pas lu Roth.”
Mais là, depuis quelques jours, on le sent bien Philip Roth, on va commencer par une nouvelle de “Goodbye, Columbus” : une jeune fille juive qui perd son stérilet dans une piscine publique.

Le métro, le matin…
Le métro, le matin. Suivant les lignes, suivant les heures, c’est peut-être là que l’on sent le mieux ce qui se passe dans la société. On est assis ou debout, très prêt des autres voyageurs. Trop prêt souvent.
On entend des conversations, on voit les écrans de portable… on laisse traîner ses yeux et ses oreilles. Ou plutôt, il faut bien l’avouer, on est terriblement attiré par l’intimité de l’autre. On est terriblement curieux de ces dialogues humains attrapés au hasard. Faut croire que c’est comme ça. Il y a tellement de monde, que l’on arrive à s’imaginer invisible. La fille blonde, là, juste là, qui sourit en lisant un texto…
Il y a onze ans, Riad Sattouf commençait à dessiner une chronique hebdomadaire dans “Charlie Hebdo”. “La Vie secrète des jeunes”, c’est aujourd’hui, trois albums. Des tranches de vie d’une époque que nous voyons passer, sans vraiment la regarder. Un regard précis, cynique, dérangeant. S’asseoir à la terrasse d’un café et observer. Écouter un couple dans le métro, en train de s’insulter. Ça passe sous nos yeux, Sattouf l’attrape.
Intéressant le métro, car tellement caractéristique des différentes catégories sociales. Il y a ceux que l’on voit, qui tous les matins partent à la même heure, que l’on repère rapidement, et ceux qui s’y sont installés car ils n’ont pas d’autres lieux où aller. Ceux qui interpellent pour demander une pièce, un Ticket Restau… un sourire. Et puis ceux que l’on ne voit jamais, parce que pour eux, le métro est trop populaire, trop dangereux, trop sale.
Les saynètes dessinées par Riad Sattouf, on les a toutes côtoyées un jour. Et c’est peut-être ce qui nous met mal à l’aise : on se rend compte de ce que l’on n’a pas vu. Des moments de banalité extrême, mais qui en racontent beaucoup sur les obsessions du quotidien.
Particularité du style Sattouf : il retranscrit le langage du métro, du bus de la terrasse de café, comme s’il s’agissait de textos. Et ça sonne juste, car c’est ce que l’on perçoit. Les gens, les jeunes parlent comme ils tapent sur leur smartphone. “Oui, T’Sé quoi, j’vé…, atend, T’Sé quoi, j’vé passer.”
Le métro, le matin, c’est souvent l’occasion de découvrir que la normalité du silence ambiant dévoile des petits grains de sable visuels. Là, le mec à côté ? C’est normal, cette patte d’ours en peluche orange qui sort de son blouson ?
Et l’on entend Jean-Claude Van Damme sur la ligne 9 du métro parisien : “Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée. S’il y a quatre personnes autour de toi et qu’elles te semblent normales… c’est pas bon !”

La fin d'une utopie
Le 1er mai dernier, on est parti découvrir le Familistère de Guise, dans l’Aisne, pas très loin de la Belgique. Tous les ans, la fête du Travail est l’occasion de rappeler l’aventure utopiste de Jean-Baptiste André Godin, un industriel du XIXe siècle, qui bâtit un Palais social pour les ouvriers de son usine de poêles en fonte.
C’est finalement très troublant de sentir les résonnances avec ce que l’on vit aujourd’hui. Ce miroir Révolution industrielle / Révolution numérique.
Au XIXe naissant, le capitalisme prêchait l’avènement des machines comme un facteur de progrès, qui allait permettre à la société de mieux vivre. Déjà, le discours sur l’avenir et son monde meilleur. Sauf que, très jeune, Godin parcourt la France pour perfectionner son métier de serrurier. Et là, surprise, ce qu’il découvre, c’est la misère et l’exploitation des travailleurs par une classe privilégiées. C’est douze à quinze heures de travail par jour. On parle d’avènement de la machine au service du peuple mais sur le terrain, l’asservissement généralisé est devenu la règle.
De retour dans le Nord, Godin devient rapidement un industriel à la tête d’une importante fonderie et manufacture de poêles à charbon en fonte de fer. Sauf que son projet est beaucoup plus ambitieux : il est persuadé qu’il peut créer un modèle de société nouvelle, plus égalitaire. Plus juste.
En 1842, Godin découvre les écrits du philosophe Charles Fourier et c’est le déclic. Son phalanstère à lui sera un familistère bien réel. À proximité de son usine de Guise, il fait bâtir, à partir de 1859, un complexe d’habitat collectif destiné à accueillir jusqu’à 2 000 personnes. Un Palais social qui offre “les équivalents de la richesse” à ses habitants.
Le Familistère mettait à la disposition de la communauté les avantages habituellement réservés aux individus fortunés. L’hygiène, la santé, l’éducation, le confort, les loisirs. Godin est persuadé que l’émancipation sociale peut profiter à tous. Dans un premier temps, les ouvriers sont sceptiques… un chef d’entreprise qui veut le bonheur de tous, ça cache surement quelque chose !
En 1880, Godin va plus loin, il dépose les statuts de l’Association coopérative du Capital et du Travail, société du Familistère de Guise. Les travailleurs deviennent associés et propriétaires de leur outil de travail.
On fête cette année les cinquante ans de Mai 68. Cela correspond aussi à la fin de l’aventure utopique de Godin. En juin 1968, après quatre-vingt-huit ans d’existence, l’Association s’est dissoute et l’usine de Godin a été vendue. Problèmes économiques, mais surtout, l’esprit coopératif et solidaire du départ avait disparu.
L’envers du paradis, la convivialité obligatoire devenait insupportable aux habitants du Familistère de Guise. Une utopie révolutionnaire naissait sous les pavés, un monde nouveau semblait possible, tandis qu’un autre disparaissait.

Soudain devant Notre-Dame-de-l’Assomption…
Week-end ensoleillé sur Paris. On passe tranquillement en vélo, rue Saint-Honoré. Et soudain, au niveau de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, on entend des cris… sans trop reconnaître la langue.
Mais à l’intonation menaçante, il y a de fortes chances qu’un mec soit en train de gueuler : “Je vais te crever, ordure !” Cette église abrite la communauté religieuse polonaise de Paris. Et là, on voit trois hommes en train de courir sur la place. On s’arrête, nous sommes plusieurs à regarder ce qui semble être un règlement de compte.
Les hommes, en chemises, se tapent dessus avant qu’un des trois ne s’éloigne, la gueule en sang. Une femme près de nous intervient : “Non, mais c’est pas possible, il faut absolument éviter ça ! Toute cette violence, mais enfin, c’est inacceptable !”
Et là, on se dit que c’est finalement très rare aujourd’hui de voir des bagarres dans la rue. Que ça l’était beaucoup moins il y a cinquante ans. Que ça faisait même partie du quotidien. On nous reparle de Mai 68, mais en 1968, les fachos d’Occident, munis de barres de fer ou de battes de baseball cherchaient la baston avec des bolchos d’extrême gauche… et ça ne choquait personne.
L’on nous dit que le monde d’aujourd’hui est beaucoup moins violent qu’avant, que la violence physique serait beaucoup moins répandue. Mais la violence a-t-elle vraiment disparu ou s’agit-il d’une mutation ? On met la violence à distance en devenant modéré. En apparence.
Dans les cours de lycée, on ne voit plus trop d’ados s’écharpant pour une histoires de meufs. Par contre, les cas de harcèlement, d’humiliation sur les réseaux sociaux explosent. La violence serait devenue invisible, intériorisée.
Dans un très beau texte de 1939, la philosophe Simone Weil, exprimait déjà cette idée : “La force qui tue est une forme sommaire, grossière de la force. Combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante en ses effets, est l’autre force, celle qui ne tue pas ; c’est-à-dire celle qui ne tue pas encore. Elle va tuer sûrement, ou elle va tuer peut-être, ou bien elle est seulement suspendue sur l’être qu’à tout instant elle peut tuer…”
Pas de sang, pas de nez cassé. C’est la violence actuelle, celle de la pression sociale, de la tyrannie économique, c’est le burn-out généralisé dans le monde de l’entreprise. Les suicides chez Orange, les licenciements par centaines ou milliers au moment où les actionnaires du CAC 40 n’ont jamais touché autant de dividendes. C’est en plus, au quotidien, la violence de la visibilité recherchée sur les réseaux sociaux.
On regarde l’homme blessé qui vient de sortir un mouchoir. Il s’est assis sur un banc. Les deux autres, la chemise tachée de sang, sont rentrés dans l’église. La messe n’est pas encore terminée. Ils vont pouvoir s’agenouiller et communier avec leurs familles.

On a brûlé le père Noël
C’était au siècle dernier à Dijon. La France sortait de la guerre. On a découvert cette histoire, il y a quelques années, en tombant par hasard sur un petit livre de Claude Lévi-Strauss. L’anthropologue s’était passionné pour ce mythe persistant, au point d’écrire un article dans la revue « Les Temps modernes ».
Hiver 1951. Le bruit courait depuis un moment dans les rues de la capitale des ducs de Bourgogne. Les autorités ecclésiastiques avaient exprimé leur désapprobation, face au regain d’intérêt accordé par les familles et les commerçants, au personnage du père Noël. L’Église dénonçait une « paganisation » inquiétante de la fête de la Nativité, qui détournait l’esprit public du sens proprement chrétien de cette commémoration, au profit d’un mythe sans valeur religieuse. On parlait de provocation.
Et là, brusquement, les esprits s’échauffent. Le dimanche 23 décembre 1951, l’animation commerciale organisée avec plusieurs pères Noël, déclenche une réaction violente. À la nuit tombée, on regroupe 250 enfants des patronages devant la cathédrale Saint-Bénigne, et là, sous leurs yeux, Jacques Nourissat, le jeune vicaire de la paroisse, enflamme un mannequin du père Noël haut de 3 mètres !
La France entière est sous le choc. Tous les grands supports de presse commentent le fait divers. « Point de vue - Images du monde » en fait sa Une, « On a brûlé le père Noël ». « France-Soir » : « Devant les enfants des patronages, le père Noël a été brûlé sur le parvis de la cathédrale de Dijon. » Grosse émotion. Car la figure du père Noël est toute récente. Elle existe en France depuis le début du XXe siècle, mais timidement. À cette époque, il a l’allure d’un pauvre colporteur chétif et discret, ne faisant pas d’ombre à la célébration religieuse.
Tout change après la Seconde Guerre mondiale. Celui qui arrive dans le paquetage des soldats américains, avec le plan Marshall et la marque Coca-Cola, est beaucoup plus généreux. Il affiche une bonhomie qu’il n’a jamais eue sur le Vieux Continent. Ce père Noël que l’Église brûle en place publique, c’est le signal fort d’une société qui bascule d’une pratique religieuse à une foi nouvelle dans la consommation de masse. Et comme après l’horreur de la guerre, bon nombre ne peuvent plus croire en Dieu… on se reporte sur les enfants, en leur demandant de croire un peu, le temps de quelques années, au père Noël.
Et Lévi-Strauss de poser la question : « Il ne s’agit pas de justifier les raisons pour lesquelles le père Noël plaît aux enfants, mais bien celles qui ont poussé les adultes à l’inventer ! »

"I’m the Dude, man !"
Quand même, la claque qu’on a reçue en revoyant le Dude buvant des White Russian dans « The Big Lebowski » des frères Coen. Le dernier film culte du XXe siècle. Une ode à la non-performance.
En 1998, « The Big Lebowski », quasi contemporain de « Matrix », annonçait la révolution numérique dans laquelle nous nous sommes trouvés propulsés au XXIe siècle. Parce que, faut bien se l’avouer, qu’est-ce qu’on s’est pris dans la gueule, depuis vingt ans. La classe du Dude, en peignoir pourri et sandales de cuir, loser magnifique, branleur héroïque, c’est sûr qu’on est loin des winners en veste casual chic Gucci et baskets Balenciaga.
Fini, le temps de la glande, du rien faire, du lever à pas d’heure. Notre quotidien est devenu startupé, chaque déplacement s’est ubérisé. On n’arrête pas de faire des to do lists qui s’allongent sans que l’on comprenne ce qui se passe. On est devenu « manager » de notre quotidien. Et le week-end, c’est encore pire. Il faut faire le ménage, les courses, les lessives, ranger l’appart, descendre les poubelles. On enchaîne sur une expo « incontournable » qui va bientôt fermée ! Arrivé sur place, 45 minutes de queue, car bien évidement que tout le monde se dit la même chose. Pareil pour le film événement qui ne va plus être à l’affiche dans une semaine ! Le resto qui vient d’ouvrir, une page dithyrambique dans le Fooding ! Le rythme de la semaine a débordé sur le week-end.
Alors oui, échapper, le temps d’un café, au diktat de la performance individuelle. « Non désolé, là, je ne suis pas en train de réfléchir à un énième projet à venir. Non là tu vois, on est samedi, je bois un café allongé, et… comment te dire, je ne pense à rien, sinon à boire un café allongé un samedi à 11 heures, en regardant par la fenêtre. » « Fuck it, Dude. Let’s go bowling. »
Reprendre un café et se dire qu’on va se trouver un pull. Acheter un pull à l’approche de l’hiver. On va juste faire ça… trouver un pull. Le garder sur soi, en sortant de la boutique. Et marcher sans but précis, en se disant qu’on a bien chaud, là, le long du canal Saint-Martin. Et ça sera tout pour la journée, « Go slow, man ». Et de repenser au Dude.
— Vous avez un emploi, Monsieur Lebowski ?
— Permettez-moi de remettre les pendules à l’heure. Je ne suis pas Monsieur Lebowski, c’est vous Monsieur Lebowski. Moi, je suis le Dude, c’est comme ça qu’il faut m’appeler. […]
— Avez-vous un emploi, monsieur ?
— Un emploi ?
— Ne me dites pas que vous cherchez un emploi dans cette tenue un jour de semaine ? »
— Un jour de… Quel jour on est ?
Vous avez tout vu !
Une petite erreur au chargement