
Pauses by Noise
Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.

T’as voulu voir Vierzon !
Dans le train, c’est toujours le même pincement au cœur, quand on sort du tunnel à quelques kilomètres de Vierzon. J’ai quitté la ville adolescent et cela fait des années que l’on voit Vierzon se dégrader, comme tant de petites villes de province.
Je regagne la sortie de la gare en attendant que ma mère, aujourd’hui très âgée, vienne me chercher.
« — Ça faisait longtemps que je ne t’avais pas vu ! » L’homme se tourne vers moi. C’est un ancien voisin de mes parents. L’occasion de parler.
« — Comment ça va, la vie à Vierzon ? »
« — Compliqué ! Ça devient compliqué pour des vieux comme moi, avec une petite retraite. J’ai lu ça dans le “Berry Républicain”, on fait aujourd’hui partie des 10 départements où la situation est alarmante. Tout est alarmant.
Il faut attendre 4 jours pour voir un généraliste, plus de 50 jours pour obtenir un rendez-vous chez le gynéco. Plus de 100 jours pour pouvoir consulter un ophtalmologue. Les gens vont à Tours ou à Orléans, c’est à 80 kilomètres.
C’est du carburant, c’est de l’argent. Mon fils pareil, il bosse à Nevers, c’est 70 kilomètres. On roule tous au diesel, depuis l’augmentation du début d’année, c’est 16 euros de plus par mois. Alors évidement tu vas me dire, c’est pas grand chose… mais quand on est au smic, j’ai vu ça à la télé, les loisirs, pour un smicard, c’est 32 euros par mois, donc on rogne là-dessus, sur les petits plaisirs. Il reste pas grand chose.
Et puis tout se dégrade. Tu te rends compte, aujourd’hui, il y a moins d’habitants à Vierzon que quand tu es né, il y a plus de cinquante ans. Vierzon se vide.
On subit une désertification massive des services publics. La Poste, les écoles primaires, des services de l’hôpital qui ferment. Le commissariat est dans un état lamentable, avec de moins en moins de policiers. Ils ont même supprimé la BAC. T’en as peut-être entendu parlé, la Cour des Comptes vient de demander à ce que les villes de moins de 50 000 habitants (avant, c’était 20 000) passe sous la bannière de la gendarmerie. Donc le commissariat en ville est menacé. La cour d’appel va fermer, elle aussi. Il y a moins de trains et ce qui nous à tous mis au tapis, c’est l’annonce de la fermeture programmée de la maternité en 2019.
Là-dessus, tu rajoutes la limitation de vitesse à 80 km/h et le contrôle technique renforcé en 2019, qui va envoyer à la casse ma voiture d’occasion… C’est une voiture que je bricolais avec un copain mécanicien. Je pourrai plus le faire ».
Daniel me parle depuis deux minutes, et sa colère monte. Ma mère vient d’arriver. Elle descend de voiture. Elle porte un gilet jaune, comme plus de 2 000 personnes dans le seul département du Cher, ce samedi 17 novembre. Je l’embrasse.

Causalité ou corrélation ?
On était tranquillement en train de regarder passer une fille en jupe rouge, quand Régis nous interpella : “Tu y crois à cette histoire de développement des big data qui nous aurait fait passer de la causalité à la corrélation ?”
Et là, comment dire ? Comme un blanc en terrasse, un trou noir spatio-temporel…
“— Non mais, ça s’est mal passé ta soirée hier, avec Eléonore ? C’est le pain sans gluten qui t’est resté sur l’estomac ? C’est quoi, ces conneries ?
— J’ai entendu ça sur France Culture. Un podcast, cette nuit quand je n’arrivais pas à dormir, un peu à cause de Eléonore, oui, c’est vrai ! Les spécialistes discutaient autour de ça, causalité et corrélation.”
La jupe rouge a disparu, un nuage nous masque le soleil. Régis poursuit.
“— On va faire simple, la corrélation, tu relies deux données, et c’est effectivement ce que les big data brassent à très grosse échelle, aujourd’hui. Ils accumulent une somme considérable de données sur chaque individu. Ils te réduisent même à ça… et ils croisent tout ça en fonction de ce que l’on veut faire dire. Et ça marche à tous les coups. Exemple, quand t’es malade. Surtout ne va pas à l’hôpital. La probabilité de mourir dans un lit d’hôpital est 10 fois plus grande que dans ton lit, à la maison.”
On décortique. On ne meurt pas plus parce qu’on est dans un lit d’hôpital. Mais si on est à l’hôpital, c’est sûrement parce qu’on est plus sérieusement malade. Et dans ce cas, la probabilité de mourir est plus grande.
A l’inverse, pour déterminer la nature du lien de causalité entre plusieurs éléments, c’est plus complexe. Ça marche pas bien avec les algorithmes qui sont finalement… très binaires. La causalité, cela demande du temps et de la distance, c’est du billard à 5 bandes.
Et Régis de reprendre :
“— Moi par exemple, à chaque fois que je mange du chocolat, cela me donne des boutons. Donc, d’après toi, c’est de la causalité ou de la corrélation ?
— OK, tu as deux éléments. Tu manges du chocolat et des boutons apparaissent. Tu fais le lien entre la consommation de chocolat et l’apparition de boutons. Corrélation OK. Et pourtant, tu peux voir les choses avec plus de distance… Si tu manges du chocolat, c’est peut-être que Eléonore, hier soir, elle t’a stressé, et c’est peut-être le stress qui te colle des boutons. Stress, chocolat, boutons. Tu vois ?
— T’as raison, faut vraiment que j’arrête le chocolat !”
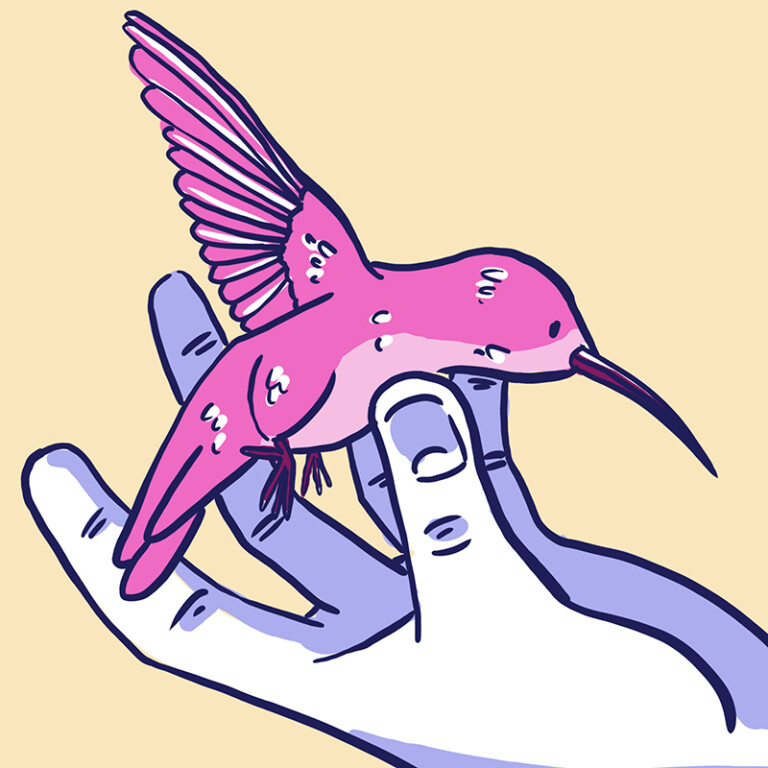
La part du colibri...
Il y a des lundis matins, on a les mains coincées au fond des poches. « Je sais, Régis, qu’il faut se battre pour que la planète ne parte pas en vrille. Je te parle même pas des sauterelles et des insectes qui disparaissent par tombereaux entiers… mais c’est pas à ma portée ! A quoi bon, on a un ministre au gouvernement, c’est à lui d’intervenir. Pas à moi ! »
Et là, on se souvient d’une histoire que l’essayiste et poète Pierre Rabhi raconte souvent. Une légende amérindienne. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés observaient impuissants le désastre. « On ne peut rien faire, sinon se mettre à l’abri ! » Seul un petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Quelques heures passent, et le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui lance : « Non mais Colibri ! T’es pas un peu dingue ? Ce n’est pas avec trois gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri de lui répondre : « Je le sais, mais je fais ma part. » Agir à son échelle, cela commence simplement par ça… et même si, pris isolément nos actes semblent dérisoires, c’est grâce à la somme des dérisoires que les choses peuvent changer.
Une autre histoire. Al Gore s’est présenté deux fois à l’élection présidentielle américaine. Deux fois, il a été battu. En 2000, il s’est fait voler sa victoire, par George W. Bush. Donc les combats difficiles, il connaît. Son film La vérité qui dérange a marqué les esprits. Oui, on peut encore sauver la planète !
Al Gore raconte souvent une autre parabole d’oiseau, pour faire comprendre le rôle de chacun. C’est l’histoire d’un jeune garçon très malin qui veut piéger un vieil homme réputé pour sa sagesse. Il vient le voir, il attrape un petit oiseau entre ses mains, et il demande au vieil homme : « On m’a parlé de ta sagesse et de ta lucidité. Sauras-tu me dire si l’oiseau que je tiens dans mes mains est mort ou vivant ? »
Alors bien sûr que le vieil homme saisit le piège : s’il dit que l’oiseau est vivant, le jeune homme va le serrer dans ses mains et le tuer, et s’il dit que l’oiseau est mort, le jeune homme va ouvrir ses mains et l’oiseau va s’envoler. Il réfléchit un instant, regarde le garçon et lui dit : « La réponse est entre tes mains ! »
C’est exactement la même chose pour le changement climatique. La réponse se trouve entre nos mains. Elle n’est pas seulement entre les mains des gouvernants. « Chaque individu a un rôle à jouer dans le changement climatique, ce serait une erreur d’être dans l’attentisme. Nous finirons par y arriver, martèle Al Gore. La vraie question est de savoir quand. »

Bêtes de nuit !
Et cette fois-ci, c’est les chauves-souris qui se font la malle. En dix ans, c’est près de 40 % des “souris volantes” qui ne volent plus…
Logique, toujours le même schéma… 80 % des insectes ont disparu, les chauves-souris mangent des insectes, donc plus rien à manger, donc plus de chauves-souris… logique. Les chauves-souris, c’est la nuit. Et ça devient compliqué, puisqu’on se rend compte qu’un paquet de bêtes plus ou moins grosses, ne disparaissent pas, mais deviennent invisibles. Elles se cachent le jour pour ressortir la nuit.
Tu prends le coyote dans les montagnes de Californie, par exemple, celui qui court après Bip Bip, en se jurant d’avoir la peau de ce grand géocoucou supersonique. Eh bien, c’est fini. Le coyote vit désormais exclusivement la nuit.
Ce n’est même pas une question de menace. C’est notre présence envahissante qui suffit à faire fuir les animaux. Nous ne partageons pas la planète, nous en avons pris possession. Nous l’avons envahie.
Nous sommes toujours plus nombreux sur cette Terre, et même si nous nous agglutinons dans les mégalopoles, ça déborde de partout. Car il faut bien nourrir tout ce monde, en développant l’élevage et la culture qui détruisent les zones sauvages.
Et puis il y a le développement des loisirs, car l’homme adore aller de plus en plus loin pour vivre ce sentiment de découverte des contrées encore vierges. Et vas-y que je te passe chez Decathlon pour acheter des chaussures et de l’équipement, et que je me lance dans des coins où très peu de monde s’est aventuré, enfin je crois.
Sauf que les animaux, ça les dérange, tout ça. Si l’on prend l’éléphant du Kenya, par exemple, il préfère aujourd’hui vivre la nuit, se déplacer, manger… alors que la nuit, un éléphant, ça ne voit pratiquement rien. Mais il préfère ça à la présence de l’homme.
Car la chance des animaux, c’est que l’homme a peur du noir, aussi bien les enfants que les adultes, et que la nuit, il dort. Les animaux ne font pas d’horribles cauchemars, ils s’adaptent beaucoup mieux que nous à l’obscurité.
Tout ça ressemble à l’époque des dinosaures, où pour éviter ces prédateurs aux dents longues, quantité d’animaux ne sortaient que la nuit. Ce n’est qu’après l’extinction des grandes bêtes, que les petits mammifères ont exploré la lumière du jour.
Aujourd’hui, la grosse bête, c’est l’homme qui renvoie le peu de bestioles encore sur pattes dans l’obscurité.

Ne pas oublier le pack de bière
Ça tient à presque rien, mais ce matin-là, on a tout de suite senti que ça n’allait pas fort pour Régis, quand il a posé son sac. Le regard tombant, la voix à peine audible et la main qui glisse mollement.
– C’est la bière qui n’était pas fraîche, hier soir ?
– Arrête de déconner ! Je suis complètement angoissé, le truc qui te tient le bide dés le réveil…
– C’est de l’angoisse ou de la peur, Régis ?
– T’es lourd avec tes considérations philo à deux balles, tu vois pas que ça va vraiment pas, non ? Ça t’arrive jamais, le flip existentiel à plus savoir pourquoi tu te lèves ?
– Si, bien sûr, mais ce n’est pas un détail, ma question. L’angoisse, c’est impalpable, on ne sait pas ce qui ne va pas, on ne sait pas pourquoi on n’est pas bien. Y’a pas d’objet dans l’angoisse, et ça c’est flippant. Alors que la peur, je la tiens presque dans la main, on a peur de quelque chose. Ce qui est important, c’est de prendre l’angoisse et de la faire glisser sur une peur que tu localises. La peur du noir, par exemple, la peur du sommeil.
– Là, en gros, ce qui m’angoisse, c’est ce putain d’anniversaire bientôt, ou plutôt, c’est le flip de la mort… Oui, c’est ça, je me réveille avec ça en tête…
– OK, c’est ce que je te dis. Si tu arrive à faire glisser ton angoisse vers une peur, ça devient jouable. L’angoisse de la mort, tu la transformes en la peur de vieillir. La mort, tu n’y peux rien, t’as pas de prise. Par contre, la peur du vieillissement, tu peux lutter, tu prends soin de toi, tu fais gaffe à pas trop picoler. Tu vois, tu soignes ta peau, tu vas courir le dimanche matin. Il n’y a pas de miracle, la peur, tu ne la fais pas disparaître… tu l’apprivoises, tu la tiens à distance. Comme un clébard que tu tiens en laisse, tranquille. Encore un conseil, simple… tu évites la radio le matin, les journaux d’information. Tu as remarqué, sur France Inter, sur BFM, les journaux nous donnent l’ordre d’avoir peur, d’avoir peur tout le temps. Et qu’est-ce que tu fais, quand tu as peur ? Tu passes au magasin et tu achètes, tu consommes. Tu ne fais pas disparaître ta peur, tu la noies en mangeant.
– Waouh, je comprends, enfin… donc là, ce que tu me conseilles, c’est d’aller chercher un pack de Budweiser et de le mettre au frais ? C’est bien ça ? Ah oui, j’oubliais la crème de soin du visage !

"Continuez tout droit."
À 10 kilomètres de Valence, on avait bien vu les panneaux routiers indiquant des travaux sur le pont du Rhône, mais on avait continué. Des panneaux “Déviation”, précisant qu’à 500 mètres, la route était barrée…
… mais on avait sagement écouté le GPS qui nous répétait : “Continuer tout droit”. Et là, on se retrouve devant la berge avec une route coupée par de grands plots rouges et blancs. Et toujours l’injonction du GPS : “Continuez tout droit”. On regarde, médusé.
À ce moment-là, plutôt que de revenir au point de départ de la déviation, on se la joue plus malin, genre pigeon voyageur avec mission de confiance. Et l’on s’embarque sur une petite route pensant longer le fleuve… pour se retrouver sur une aire sableuse au milieu de rien. De rien du tout. Genre ambiance à la David Lynch avec des virevolants, ces boules d’herbe qui roulent, ou bien à la Into the Wild où t’es dans le bus et que tu ne bouges plus…
“Faites demi-tour”, “Tournez à droite”… On n’en peut plus du GPS car l’on prend subitement conscience que l’on n’a absolument pas regardé le paysage et que maintenant, on est perdu. Avec une question en tête : Est-ce qu’il vaut mieux descendre en aval pour trouver un autre pont ou remonter pour traverser en amont ? Sauf que ça, le GPS, il ne le sait pas.
Alors bien sûr que quand on regarde notre smartphone, on voit bien la pastille qui nous dit “Vous êtes ici”. Sauf qu’ici, on ne sait pas où c’est ! “Sympa de m’indiquer que je suis le centre du monde, mais ça ne me dit rien de ce que je dois faire.”
On ouvre la boîte à gants pour chercher une carte routière. On descend du véhicule et l’on déplie l’accordéon sur le capot. “Voilà, c’est pas compliqué, le prochain pont est à 12 km”.
Il fut un temps, pas si lointain, où quand on partait en vacances, on s’attablait la veille pour préparer l’itinéraire du voyage. On se retrouvait devant une grande carte. On prenait des notes et on visualisait le parcours. On calculait la distance et approximativement, on estimait le temps pour pronostiquer où l’on pourrait s’arrêter déjeuner. On découvrait que sur le chemin, à quelques kilomètres, il y avait le Palais idéal du facteur Cheval.
La performance, le performatif, le trajet le plus court en moins de temps possible… L’idéologie managériale a tout envahi. Seule compte aujourd’hui, la destination, le but. On en oublie le voyage et ses imprévus. La dérive chère à Guy Debord.
On va prendre le temps de regarder et plutôt que d’avoir l’œil rivé sur l’écran, on va juste ne plus être obnubilé par notre position. On va commencer par observer dehors, le Rhône, la berge, la nature. Avec en tête, une inscription que le facteur Cheval avait gravé au-dessus d’une porte de son palais : “Ce n’est pas le temps qui passe, mais nous.”

Une poubelle vivante
Faut se l’avouer, on ne sait pas comment faire pour que les gens prennent conscience qu’ils jettent un tombereau de déchets, tous les jours.
Il paraît même que nous autres, en France, on est les mauvais élèves du tri sélectif en Europe. Poubelles jaunes, poubelles vertes, conteneurs à verre… ça rentre pas, on n’y arrive pas. On a le sentiment que plus on trie et plus les industriels rajoutent de l’emballage.
Un activiste américain, vient d’avoir la bonne idée pour que tout le monde se rende bien compte de ces quantités de plastique et de carton. “Hé mec, un Américain produit deux kilos d’ordures par jour… non mais tu te rends compte !”
Alors ce qu’il a trouvé comme idée simple, c’est de porter les déchets sur lui, au fur et à mesure qu’il consomme. Il s’est fabriqué une combinaison poubelle. Il mange ce que mange Bob, Donald ou Andrew, des pizzas, des burgers, des frites. Il boit des sodas, des cafés, se tape des milk shake... Et les emballages carton, les gobelets, les pots de glace vides s’accumulent dans les dizaines de sacs en plastique transparent qu’il stocke sur lui.
Il se balade comme ça dans les rues de New York, habillé en poubelle vivante. Rob Greenfield qu’il s’appelle. Et son action, Trash Me.“Non mais Rob, les ordures, ça sent pas très bon, quand même. Tu fais comment pour supporter ça ?” C’est simple, pour les déchets organiques, il les remplace par le même poids d’une matière inerte comme le sable.
En France, la mobilisation s’organise. Ce sont des “plastic attacks” qui sont prévues pour le 2 juin. Pas compliqué. Tu fais tes courses, et une fois passé la caisse, tu enlèves tous les emballages inutiles et tu laisses tout sur place, pour que le distributeur se démerde avec ça et commence à se poser des questions.
L’oignon emballé individuellement dans sa barquette plastique, le concombre sous cellophane, comment tu justifies un truc pareil ? C’est en Allemagne, en Belgique, au Canada, en Espagne et partout dans le monde que des actions ont déjà été menées avec succès.
On en parlait avec Régis à la machine à café. Deux kilos de déchets par jour, ça fait 60 kilos par mois… En gros, tu produis en un mois plus ou moins ton poids en déchets. Rien qu’à l’idée, on va se manger une carotte sans emballage !

Langue de bois
Cela vient d’un tweet de Sciences Po Lille. C’est un tableau tiré d’un ouvrage intitulé : “Langage et pouvoir en interaction”. Titre du tableau : “Le parler creux sans peine”.
En l’on se dit, bluffé, que le discours vide, ça se travaille visiblement avec méthode. Une forme de cadavre exquis surréaliste, sauf que là, ce n’est pas pour agrémenter les soirées entre potes, c’est juste pour embrumer les sceptiques et les médias.
C’est très efficace : sujet/verbe/complément d'objet/adjectif/complément du nom. On choisit un mot dans une colonne et on l'associe aux autres sur la même ligne ou sur des lignes différentes. Toutes les combinaisons sont possibles. Ça permet de parler en boucle, tout en donnant le sentiment d’être un expert avec une vision sur à peu près tous les problèmes du monde moderne.
On prend un exemple que l’on pioche dans le tableau, au hasard : “L’expérimentation clarifie les indicateurs systémiques du projet”. Ah oui, quand même ! Là, en général, quand dans une réunion, un orateur commence comme ça, on se dit : “Waouh… il va falloir faire profil bas, car on est tombé sur une pointure, qui a une vision à au moins vingt ans.”
Avec le recul, c’était à quelques mots près le type de préconisations que pouvait faire Jacques Attali, missionné par Nicolas Sarkozy pour présider la Commission pour la libération de la croissance. En gros un avis sur tout et qui surfe sur une vague de concepts flous.
Jacques Attali comprenait le passé, décryptait le présent et projetait le futur pour les cinquante années à venir. On avait découvert Attali avec les septennats de Mitterrand. Intellectuel brillant qui sortait des livres sur tous les domaines.
A l’époque, la grosse blague qui circulait dans les ministères c’était : “On sait qu’Attali bosse dans son bureau au bruit de la photocopieuse qui n’arrête pas de tourner.” C’est vrai qu’il faisait beaucoup d’emprunt à l’époque. Il pratiquait en virtuose et sans filet le copier/coller.
Aujourd’hui, c’est plus simple, on ne plagie plus les idées puisque l’on associe des concepts vides. Des éléments de langage que l’on colle les uns derrière les autres. On ne résiste pas au plaisir d’en refaire un. On est dans une réunion, et l’homme à la parka bleue pose une question assez terre à terre : “Et pour ce qui est de la recherche universitaire en France dans les dix années à venir ?” Réponse tableau : “Monsieur, croyez en mon expérience… on a longuement travaillé ce dossier, le management stimule les paramètres stratégiques des bénéficiaires, il faut s’y tenir !”
On en arriverait presque à verser une larme, tellement ça paraît plausible. Et de se dire que c’est à longueur de journée, que l’on entend ce genre de logorrhée. Et en face, certains journalistes, nourris au même verbiage jargonneux, de relancer par des : “Oui, bien sûr !”

Likes, cœurs et flammes
Cela fait bien vingt minutes que l’on est arrivé dans la salle d’attente de ce médecin généraliste de la place Voltaire à Paris. Il a fallu un peu de temps pour qu’on remarque un détail, mais maintenant c’est évident. Plus personne ne lit les magazines posés sur la table basse.
C’était pourtant un rituel… “Bon, qu’est-ce que je vais prendre comme journal que je ne lis jamais ? Paris Match avec Johnny Hallyday en couverture, ou bien Le Point qui titre sur le yoga ?” Et c’en est terminé de cette époque, où la salle d’attente était un salon de lecture. On se souvient même avoir discrètement arraché une page pour la recette des beignets de fleurs de courgettes.
Nous sommes huit dans la pièce et tout le monde a les yeux rivés sur son smartphone. À jouer avec son index pour faire défiler le fil des réseaux sociaux. Et l’on observe discrètement la fille au pull rouge… ses doigts qui likent, qui envoient des cœurs. Et là, de se poser une question simple et de comprendre un truc qui cloche. Pourquoi on ne paye pas pour Facebook, Twitter, Snapchat, Google et tous ces services que l’on utilise à longueur de journée ? Pourquoi tout est gratuit ?
Parce que nous ne sommes pas des clients, nous sommes le produit. Ce sont nos yeux et notre attention qui sont marchandés sur ces plateformes. Plus ces géants du numérique nous gardent connectés et plus nous déposons des likes, des cœurs, des flammes. Le like, c’est l’ADN des réseaux sociaux, c’est ce qui nous raccroche à l’application. “Faut que je vérifie combien j’ai eu de likes, aujourd’hui ! Est-ce que ma punchline sur Twitter a recueilli des cœurs ?”
Nous passons un temps considérable à donner des informations sur nos goûts, nos envies, nos opinions. Et si l’on s’éloigne un peu trop longtemps, on se fait gentiment rappelé à l’ordre. Toutes ces données spontanées, toutes ces traces comportementales qu’on laisse permettent aux algorithmes de dresser des profils d’une extrême précision. Il suffit alors à Google, Facebook et consorts de revendre tout ça à de nombreux annonceurs pour que l’on reçoive des pubs très ciblées, qui nous enferment dans la répétition de nos habitudes. C’est ça, le vrai prix de la gratuité sur internet, être réduit à la régularité de nos comportements.
Nous ne sommes pas des clients, nous sommes le produit. Le médecin arrive au bout du couloir. “Bonsoir, c’est à qui ?” Pas de réaction. “C’est à qui ?” insiste-t-il. Une femme à l’écharpe à fleurs lève la tête. “Excusez moi docteur, j’étais en train de regarder mon compte Instagram, je me suis fait liker 12 fois le dessert à l’orange que j’ai posté ce midi, ça fait un bien fou.”

Du coup, c'est clair !
On ne l’a pas vu venir, mais rapidement, c’est devenu insupportable, comme un pivert qui te frappe le crâne. “Du coup” et là, du coup, du coup… ça a pris une place considérable.
Alors bien sûr que les tics de langage, cela a toujours existé, mais qu’est-ce qui s’est passé pour qu’aujourd’hui, au bureau, aux terrasses de café, à la radio ou à la télévision, cela prenne autant de place dans les discussions ?
On sent bien que ça agit pour retenir l’attention de l’autre… pour qu’il n’y ait pas de décrochage. On est tellement flippé à l’idée que l’autre ne soit pas attentif, qu’on n’arrête pas de l’attraper à coup de tics. “En fait, j’attendais Régis, et là tu vois, il était en retard. Du coup, j’ai encore attendu et du coup quand il est arrivé, t’as vu, j’étais en colère… voilà, c’est clair non ?”
C’est comme si on était en train d’expliquer un truc complexe et qu’il fallait articuler tout ça comme un prof de physique devant un tableau noir. Sauf que souvent, ce qu’on raconte est d’une banalité sans nom. Ça prend les apparences d’une articulation logique, sauf que souvent, il manque le deuxième élément.
“Du coup, j’avais faim, j’ai pris une banane, et là du coup, j’avais plus faim.” On structure la phrase qui devient tellement tendue du string, que le discours se retrouve saturé par la répétition. On en arrive à ne plus entendre que ça… le pivert qui frappe à coup de “du coup” !
Le truc, c’est que c’est vite contagieux. Et plus on remarque ces petits mots, plus on se chope le virus, et l’on se met à en mettre partout. La semaine passée, on participait à un jury et on fait remarquer avec diplomatie, à un étudiant que le “du coup” est vraiment trop fréquent dans sa démonstration orale, que cela en devient irritant, au point que l’on ne perçoit plus ce qu’il veut dire.
À la fin de la présentation, un membre du jury se penche vers nous : “Tu sais quoi ? J’ai compté pour être sûr, tu as dit quinze fois ‘C’est important !’ donc, fais gaffe, on est tous contaminés par les tics de langage. Et puis, tu sais, faut pas juger, on n’a pas le même âge… il y a comme un truc d’appartenanance derrière tout ça. Tu dis ‘du coup’, parce que tu l’as repéré chez les autres. C’est comme une façon de faire partie d’un groupe… le groupe des ‘Du coup’ !”
À la grande époque de “France Soir”, Pierre Lazareff, le directeur de la rédaction, avait punaisé sur le mur de son bureau cet avertissement : “Une phrase, c’est un sujet, un verbe, un complément. Pour les adjectifs, me prévenir. Au premier adverbe, vous êtes viré !” Un poil excessif, le Pierrot, mais c’est ce qu’il avait trouvé de mieux pour informer au plus juste, sans débordement d’effets de langage. Pour informer clairement. Du coup, c’est clair.

Murs rouges
C’est Anne, ce matin, qui vient nous voir à la machine à café.
Tu sais quoi ? Mon appart, que je louais une semaine aux vacances, en Airbnb, eh bien, il est infesté de punaises de lit…
… Non mais, tu te rends compte ? Non seulement, je viens de me prendre deux avis super négatifs sur la plateforme, mais je ne peux pas partir en vacances en ce moment, et je ne sais pas comment me débarrasser de ces bestioles… Je me suis renseignée, il paraît que ce fléau gagne tous les quartiers parisiens ! Aujourd’hui, c’est des immeubles entiers qui sont infestés.
— Mais tu as loué ton appart à un éleveur de chiens ?
— Non, ça n’a rien à voir avec l’hygiène, c’est pas des cafards ! Mon appart, on pourrait le trouver dans “AD” ou “The World of Interiors”. Il est très design. J’ai regardé sur le forum de Airbnb, rubrique “punaises”… Et là, c’est le délire, des dizaines de témoignages de gens affolés qui ne savent pas quoi faire. Genre panique chez Airbnb qui constate que sur Paris, les gens louent moins. Le truc, c’est que personne n’en parle, c’est tabou. C’est comme si tu disais que chez toi, c’est un taudis.
— Airbnb, oui, bien sûr, c’est super, mais les gens n’arrêtent pas de bouger. Et donc, ils chopent des punaises à Madrid, les rapportent à Londres dans leurs bagages, avant de débouler chez toi près de la place de la République. C’est logique tout ça… La location des apparts à Paris ouvre la porte à tout ce qui vient de l’extérieur, du fric pour les propriétaires et des punaises pour les intérieurs. Airbnb, c’est des algorithmes et des mecs qui vivent dans le futur… Ils n’ont pas pensé aux insectes nuisibles.
Moi, ce que j’ai lu, c’est que ces fichues bestioles n’aiment pas trop le vert et le jaune… et qu’elles raffolent du rouge. J’ai un pote, il a fait ça : tu recouvres les murs de ta chambre en rouge, genre rouge passion, et là, tu poses du double face sur au moins un mètre de haut. Les punaises rappliquent et restent collées contre l’adhésif. Mais fais gaffe. Mon pote, il a scotché les punaises, mais il a aussi retrouvé son chien, le poil collé contre le mur.
Après, l’autre solution, c’est de demander à ton locataire Airbnb qui arrive de New York de se déshabiller sur le palier, pour vérifier qu’il n’a pas de piqûres sur le corps. Et s’il est clean, tu lui dis que la chambre rouge, c’est pour qu’il s’éclate bien !
— Euh, j’avais pas vu les choses comme ça. J’imaginais plutôt un truc du genre bombe insecticide, moins sexe peut-être, non ?

Au moins trois doigts !
C’est une maîtresse d’école qui racontait ça, l’autre soir autour d’un verre. “C’est limite la cata en classe, les enfants n’arrivent plus à écrire avec un stylo… Ils perdent patience, ils s’énervent et envoient tout balader.”
“Hé, Madame, c’est pas possible, j’ai mal au bras d’écrire si longtemps !” Faut dire qu’ils ont l’habitude des écrans qui répondent immédiatement. Et là, on leur demande de prendre le temps, de former des lettres.
“Et puis y’a pas que ça, c’est même une histoire de main, de doigt. Plus ça va, moins ils réalisent de trucs manuels qui demandent de la dextérité et du temps. Du coloriage, du pliage, du découpage… Faire un pompon avec du carton et de la laine, c’est toute une galère !”
La main, pour les gosses aujourd’hui, se résume à l’index. Sauf que pour écrire, il faut au moins utiliser trois doigts ! Et l’on a constaté que l’articulation de l’index des enfants évoluait, elle se plie dans l’autre sens que celui dont on a besoin pour tenir un crayon. Tenir un crayon devient compliqué.
Aux États-Unis, on en revient, du tout numérique où l’on écrivait uniquement au clavier (en 2016, c’étaient 45 États sur 50 qui donnaient la priorité au clavier). L’écriture manuelle refait surface dans les petites classes. Car écrire à la main permet de mieux mémoriser les lettres, les mots. Quand on écrit au clavier, on tape sur des touches, c’est toujours le même geste.
En 2007 déjà, Bill Gates et Steve Jobs débattaient du problème. Le fondateur de Microsoft défendait l’écriture manuscrite sur une tablette à l’aide d’un stylet, quand le gourou de Apple jugeait le stylet ringard et dépassé.
Pour qu’on comprenne bien la nuance, la maîtresse prend un exemple simple. “En écrivant à la main, même si on fait la même lettre, elle sera différente selon le mot. Si j’écris ‘en’ et ‘on’, le ‘n’, je ne le fais pas de la même manière, et ça crée une mémoire motrice, qui est réutilisée par notre cerveau, quand on doit identifier visuellement les lettres. Quand on apprend les lettres au clavier, on ne crée pas cette mémoire motrice. Ce qui est sûr c’est que l’écriture manuscrite peut rapidement disparaître, c’est peut-être la dernière génération d’enfants que je vois écrire en classe.”
Et la maîtresse de se retourner vers nous et de poser la question. “Et vous, au quotidien, vous écrivez beaucoup avec un crayon et un papier ? Vous envoyez des mails, vous utilisez votre smartphone… Ça fait combien de temps que vous n’avez pas écrit ?”
Vous avez tout vu !
Une petite erreur au chargement