
Pauses by Noise
Retrouvez-nous le jeudi, pour une Pause by Noise.
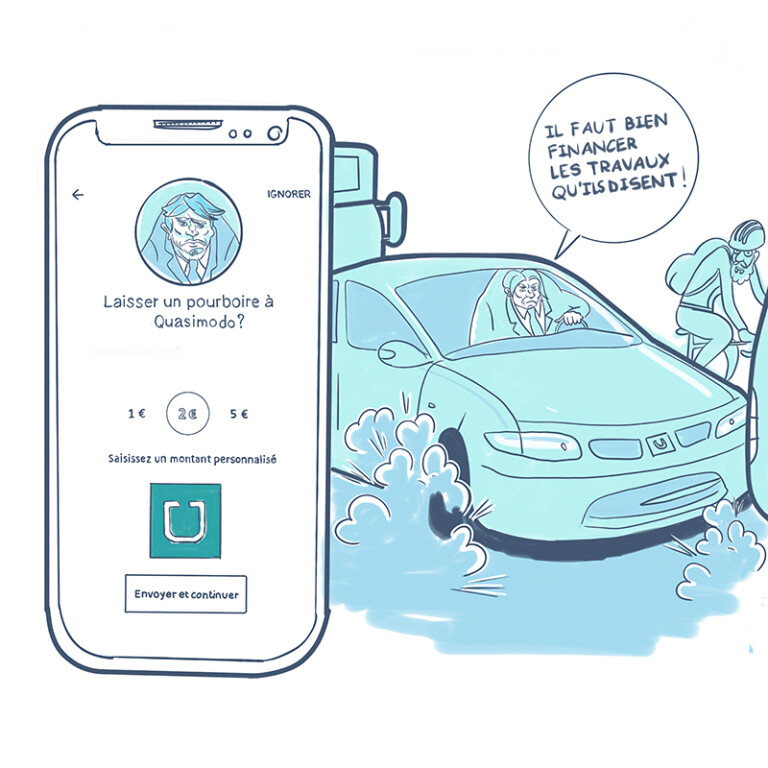
Notre maison brûle encore
Quand la flèche de Notre-Dame s’est embrasée entraînant toute la charpente du toit de la cathédrale, on a bien senti qu’une émotion forte remontait spontanément au plus profond de chacun…
Et l’on s’est dit qu’il fallait garder de l’espoir, qu’en de pareilles circonstances, l’homme était encore capable de ressentir un instinct de vie… C’est comme si un être aimé s’était retrouvé blessé, mutilé. Et d’assister à un véritable deuil physique.
Las ! Lundi dernier, l’enthousiasme est retombé, quand on a découvert à la une du « Monde », un rhinocéros noir retrouvé mort dans une réserve en Afrique du Sud. Tué pour sa corne par des braconniers. Le gros titre disait : « Alerte rouge sur la vie sauvage ». La disparition du vivant est actée, on ne reviendra pas en arrière, on peut simplement freiner le phénomène, « la sixième extinction de masse des espèces est bel et bien en cours ».
Comment ne pas ressentir de l’incompréhension ? Régulièrement dans les lieux publics, les écoles, sur les lieux de travail, on organise des exercices alerte incendie et tout le monde s’y prête considérant l’enjeu sécuritaire des plus importants.
Aujourd’hui pourtant, pour la planète, l’alerte résonne avec force, mais quelque chose nous dit que cette alerte ne nous est pas adressée… « Oui ? Comment ? Non, mais vous savez, c’est un problème de rhinocéros, d’ours polaire, ou d’iceberg… On est France, monsieur ! » On n’arrive pas à résoudre l’équation. La course à la croissance, la pollution, le réchauffement de la planète, les dérèglements des climats et des écosystèmes, la disparition des espèces…
Notre-Dame flambe : émotion mondiale généralisée… La planète entière est au bord de la rupture : rien ou très peu. L’été dernier sur la banquise, c’est un iceberg de 10 milliards de tonnes qui s’était détaché. Les glaciers fondent et disparaissent encore plus vite que les pôles.
Les inondations sont massives au Canada. En Iran, on vient de déplacer plus de 500 000 personnes en moins d’un mois. Sans parler des incendies de forêt gigantesques, des ouragans qui gagnent en puissance… Partout, du jamais vu ! Mais personne n’entend l’alerte.
Notre-Dame flambe : les dons affluent, les larmes coulent, l’État prend les choses en main pour reconstruire au pas de course. Au point que tous les spécialistes du patrimoine demandent à ce que l’on prenne le temps d’évaluer le chantier, de ne surtout pas se précipiter. Il y a urgence à attendre.
Et de l’autre, l’indifférence est quasi généralisée. « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » Encore une fois reviennent les mots de Jacques Chirac au sommet mondial de la Terre de Johannesburg en 2002. Près de vingt ans plus tard, on pourrait réactualiser la formule : « Notre maison brûle, la vie sauvage s’effondre et nous fermons les yeux. Les ouvrir nous obligerait à réagir ! »

Le printemps est déjà chaud !
Gros, gros succès que ces manifestations pour faire pression sur les gouvernements qui ne luttent par suffisamment contre le réchauffement climatique. L’urgence de dire stop, car il faut agir et vite.
C'est une nouvelle génération qui se met en marche dans les pas de cette jeune Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg, qui a décidé, il y a plus de six mois, de ne plus venir en cours le vendredi. De s’asseoir sur le trottoir avec une pancarte, à l’extérieur du parlement suédois. « Skolstrejk för klimatet », grève pour le climat.
En décembre, elle se retrouve invitée à la COP24 par l’ONG Climate Justice Now. Elle monte à la tribune : « Vous dites que vous aimez vos enfants par-dessus tout… et pourtant vous leur volez leur avenir ! Devant leurs propres yeux. Si les solutions au sein du système sont impossibles à trouver, alors peut-être devrions-nous changer le système lui-même. » Et là dans la salle, ça bronche pas. Qu’une ado prononce les mots que les politiques n’arrivent pas à dire !
L’élément déclencheur pour Greta Thunberg, c’est à 11 ans, une dépression. Et là, elle se dit : « C’est une perte de temps d’être déprimée. Je pourrais plutôt faire quelque chose de bien de ma vie… J’ai donc décidé d’essayer de faire bouger les choses. »
Et les choses bougent. Quelques semaines après, c’est L’Affaire du Siècle, une pétition pour que la France respecte enfin ses engagements pour le climat. Du jamais vu : en quelques jours, c’est plus de deux millions de signatures. Les 15 et 16 mars, dans toute la France, ce sont des milliers de gens, dont beaucoup de jeunes, qui sont descendus dans la rue à l’appel de Greta Thunberg, pour marcher : la « Grève mondiale pour le futur ».
Scandant des slogans, tenant des pancartes fabriquées le matin même. Quelques mots tracés au feutre, inattendus, décalés, provocants voire grossiers… Les mots d’une autre génération, collégiens, lycéens, étudiants qui ont bon espoir de faire bouger les choses.
« Climassacre à la tronçonneuse… Que le second degré ne reste qu’une mauvaise blague … La planète vous la voulez bleue ou bien cuite ? … Sauvons la planète, bordel … Bougez votre cul, la planète meurt … Quand c’est fondu, c’est foutu … Arrête de niker ta mer … Phoque le réchauffement climatique … Les saisons sont aussi irrégulières que mes règles … Bouffe des chattes, pas des vaches … La planète, ma chatte, protégeons les zones humides … Plus de clito, moins de glipho … La planète est plus chaude que ma chatte … Bouffe mon clito, pas mon climat … Chauffez-nous le clito, pas la planète »
Les filles sont dans la rue. C’est Georges Bernanos qui écrivait : « C’est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. » Le printemps est déjà chaud !

L’acier ou la vie !
« Marche ou crève ! » C’est un dilemme typiquement néo-libéral de non retour, auquel les ouvriers de l’usine Ilva, en Italie, ont été confrontés, en prenant part au vote sur la reprise de l’activité très polluante de leur aciérie. C’était en septembre 2018.
Ça se passe dans la ville de Tarente, dans les Pouilles. Au fil des siècles, des habitants qui pêchent et construisent des bateaux. Arrivent les années 1960, et l’Etat italien décide d’y implanter une aciérie qui va permettre le décollage économique de ce Sud italien, réputé très pauvre.
Et Ilva devient vite un monstre qui peut sortir 10 millions de tonnes d’acier par an. La plus grande usine sidérurgique d’Europe. A une époque où personne ne se pose de questions de santé. C’est comme ça que l’on a construit la partie la plus polluante du site à quelque 200 mètres du centre-ville de Tarente.
Avec comme conséquence, d’être la ville la plus polluée d’Europe. Une pollution qui a provoqué, d’après les associations, une surmortalité de 15 % dans la population. On compterait au moins 10 000 victimes liées à l’activité d’Ilva. Avec ce constat implacable… Ce qui fait vivre la ville, ce qui nourrit la population, la fait mourir aussi.
En 2012, la justice ordonne la saisie et la mise sous tutelle de l’entreprise pour « crime environnemental ». Placée en faillite, elle est renationalisée en 2015, dans l’attente d’un repreneur.
En septembre dernier, le groupe ArcelorMittal a fait une proposition et l’on a demandé alors l’avis au 10 700 employés. « Vous êtes pour ou vous êtes contre ? » Leur verdict a été sans surprise. A plus de 94 %, ils se sont prononcés en faveur du plan de reprise par le numéro 1 mondial de l’acier.
« C’est comme ça : Ilva nous donne à manger, et en même temps, Ilva nous tue », constate avec fatalisme, un ancien ouvrier de l’usine. Dans le centre-ville de Tarente, quelqu’un a écrit à la peinture noire, sur les murs en brique de l’église San Francesco de Geronimo : « O l’acciaio o la vita, devi scegliere. » (« L’acier ou la vie, il faut choisir. »)
Tout le monde est conscient que la reprise va permettre à plus de 10 000 personnes de conserver un emploi pour les cinq années à venir. Ceux qui souhaitent partir vont toucher 100 000 euros d’indemnités. Mais personne n’a voulu chiffrer le nombre de morts à venir, même si ArcelorMittal s’est engagé à investir 1,15 milliard d’euros, pour une mise aux normes environnementales d’Ilva jusqu’en 2023.
Cela fait des années que les habitants de Tarente passent devant le mur de l’église San Francesco de Geronimo en baissant la tête. Le vendredi, certains s’arrêtent pour prier.

On fait quoi après l’effondrement ?
C’est en revoyant « Le jour d’après », le film de Roland Emmerich (sorti en 2004, quinze ans déjà), que le mot s’est imposé. Effondrement. Quand le sol de la banquise se brise, que tout bascule dans le chaos… que le monde s’effondre.
Depuis cinquante ans, on ne parle que de crises. En 1984, c’était l’émission de télévision « Vive la crise » d’Yves Montand. « Allez, les p’tits gars, on se remonte les manches ! ». Crises pétrolières, crises financières, crises économiques, crises sociales, crises migratoires, crises écologiques, crises politiques…
Alors c’est vrai qu’on s’était fait une grosse frayeur avec la guerre froide, le gros flip de la catastrophe nucléaire et de la destruction de la planète. Et puis le mur de Berlin est tombé en 1989 et la menace s’est éloignée pour un temps. Mais le réchauffement climatique a pris le relais…
Le mot « crise » n’a plus cours… car ce n’est pas une crise que nous vivons, ce qui sous-entendrait un possible retour à la normale. Non, là, c’est bien d’effondrement dont il s’agit… il n’y aura pas de retour en arrière, c’est bouclé.
Extinction massive des espèces… il faut le dire haut et fort, dans quelques années, il n’y aura plus d’oiseaux, plus d’insectes. Plus de printemps ni d’automne tempérés. Plus de pétrole… Les migrations de populations vont s’intensifier, les gens vont se déplacer pour simplement survivre. Et logiquement les conflits vont se démultiplier.
C’est toute la force du mot « effondrement », qui, depuis quelques années, provoque un déclic émotionnel de l’ordre de l’électrochoc. La nostalgie du temps passé n’a plus lieu d’être. La seule question à se poser, c’est : « On fait quoi après l’effondrement ? Car à quoi bon agir si l’on sait que la fin de la civilisation est inéluctable ? »
Les collapsologues entrent alors en scène. « Cool man, tout va bientôt s’effondrer… mais nul besoin de paniquer », nous disent-ils. OK, mais c’est quoi la collapsologie ? C’est une nouvelle science transdisciplinaire qui étudie le collapsus ou la chute de nos sociétés industrielles, ce moment où les besoins de base ne vont plus être satisfaits pour la majorité de la population. Cela devrait se produire au cours du XXIe siècle et selon certains dans pas très longtemps, d’ici les années 2020 ou 2030. En cause, l’épuisement des ressources, les dérèglements climatiques, la surpopulation…
Et ce qui était perçu comme un dogme indépassable se retrouve balayé. La compétition, la croissance, l’accélération, le toujours plus. John Steinbeck qui avait connu la Grande Dépression de 1929 aux États-Unis le disait déjà : « De tous les animaux, l’homme est le seul qui boit sans soif et mange sans avoir faim. » On y est, le néo-libéralisme vient d’atteindre un seuil où tout bascule et tout s’effondre.
Alors, on n’a pas le choix et c’est tant mieux. Il va falloir ralentir. Il nous faut construire quelque chose d’autre, remettre en question notre relation au monde. Et c’est tout le paradoxe de cet effondrement généralisé qui va nous permettre de vivre autrement. De développer « l’espoir actif », de retrouver de la lucidité. De faire remonter les émotions, pour sentir réellement le sens de la vie.

La loose du snooze
On rame quand même, à genoux nous sommes ! Grosse fatigue pour finir l’année comme pour la débuter d’ailleurs…
Et tous les matins, on se maltraite en appuyant, comateux, sur le petit bouton anthracite de notre réveil… le snooze. « Non, putain, pas ça, il est 6h50, c’est pas possible, j’ai pas mérité ça… encore un peu. »
C’est juste imperceptible quand ça commence, on croit deviner que ça vient de très loin, des limbes de l’inconscient. Et puis, cela se précise, oui tu entends distinctement la vibration de la sonnerie et là, comme si tu étais entre la vie et la mort, tu choisis la vie… ce fol espoir de grappiller quelques instants à la nuit. Encore dix minutes supplémentaires, autant dire une éternité.
Et tous les matins, c’est un déchirement. Et tu ne peux plus t’en passer, c’est devenu une addiction comme d’autres le sont au jus de mandarine fraiche ou à l’héroïne. Sauf que toi, c’est le snooze.
Et pourtant, c’est pire que tout. Car ce semblant de plénitude te renvoie dans un sommeil plus profond, là justement d’où tu t’apprêtais à sortir. Car tout ton corps s’y était préparé. Progressivement depuis de longues minutes. La nuit est une alternance de cycles de sommeil léger et d’autres plus profonds. Chacun dure plus ou moins 90 à 120 minutes. Le matin, tout se met en place pour t’accompagner à en sortir. La température du corps qui avait perdu quelques degrés durant la nuit se met à remonter, le corps se réchauffe accompagné d’une production d’hormone, le cortisol qui nous assure un réveil apaisé.
Donc tout est prêt. Sauf que quand tu écrases le bouton du snooze, tu envoies un message au cerveau pour lui dire « Ok, man, on repart dans les tréfonds ! » et en quelques secondes, tout s’écroule. Tu plonges.
10 minutes plus tard, tu entends de nouveau la petite vibration, sauf que plus rien ne va, tu es juste en mode zombie qui s’est fait marabouter par un chaman de Sibérie orientale. Et ça, tu vas le regretter toute la matinée.
La seule solution, quelques soient les excès de la nuit, c’est de se lever d’un seul bond.
D’abandonner à tout jamais le snooze.

Le temps d'un gâteau
Vacances de février. C’est l’occasion de faire une pause. De prendre le temps de partager un goûter vers 16h30 avec ses enfants.
On ne sait plus trop comment c’est venu, cette histoire. Peut-être une confusion de repères au moment où l’hiver ressemble au printemps. On s’est souvenu de Lefèvre-Utile, ses gâteaux fabriqués à Nantes. Et peut-être le plus connu, même les yeux fermés, le Petit Beurre LU devenu même un nom commun, petit-beurre, avec un trait d’union.
On est en 1886, et deux talentueux artisans biscuitiers, Jean-Romain Lefèvre et Pauline-Isabelle Utile, créent un petit gâteau, simple et abordable, que l’on peut manger tous les jours. À partir de là, l’histoire se confond avec la légende.
Petit Beurre, cela aurait pu être une marque comme Granola ou Pépito, sauf que, par négligence, le nom a été déposé tardivement, en 1888. Entre-temps, la concurrence a pu inscrire “petit beurre” sur ses paquets de gâteaux. Alors nos biscuitiers se sont dit qu’ils allaient faire un gâteau bien à eux, pour que personne ne puisse les copier. Que ce temps qu’ils n’avaient pas su apprécier pour le dépôt du nom, ils allaient l’inscrire dans la forme même du gâteau.
Le Petit Beurre LU n’a pas évolué depuis plus de cent trente ans. Il suffit d’ouvrir un paquet et de tenir un Petit Beurre entre ses doigts pour se convaincre de prendre son temps et de se dire que ce gâteau a quelque chose d’une allégorie temporelle. Un disque de Nebra ou une astrolabe à grignoter…
Comme tous les enfants, on commence par croquer les oreilles, les quatre oreilles du biscuit. Quatre, comme les quatre saisons de l’année. Et puis autour, on a 52 dents (avec les oreilles) représentant les semaines d’une année. Sept cm de large pour les 7 jours de la semaine. Sur la face, quatre rangées de six points soit 24 points pour les 24 heures d’une journée. On sent pointer les Illuminati ou les sociétés secrètes qui ne sont jamais très loin. Mais non, non, pas de triangle ou de gros œil ésotérique comme sur les billets de un dollar.
Encore un détail, une inscription inchangée depuis l’origine : LU PETIT-BEURRE NANTES écrit sur 3 lignes, comme brodé. Au centre du biscuit, pile au centre, la lettre B. Et notre garçon, impatient, de nous demander : « Hé, c’est quoi, ce B ? Qu’est-ce que ça veut dire ? »
Alors comme on sèche, on se raccroche aux branches. : « Regarde bien, c’est le signe infini qui est esquissé dans le B… juste au milieu du gâteau. Des Petit Beurre LU, on en mangera toujours… jusqu’à la fin des temps ! »

L'arbre à loques
De loin, on croit deviner une décharge autour d’un arbre mort, et puis l'on s'approche. Ce sont des vêtements, des mouchoirs, des morceaux de tissu qui sont accrochés sur l'écorce ou qui pendent.
On en avait parlé avec un paysan du Calvados. “Tu devrais aller au Pré-d’Auge, c’est à quelques kilomètres de Lisieux. Y’a là-bas un arbre qui guérit les maladies de peau.”
“Un arbre à loques” comme ils disent. C'est un rituel enraciné depuis le siècle dernier. Les mêmes gestes. À côté de l'arbre se trouve une source qui aurait des vertus. On trempe un chiffon dans l'eau, on frotte sur la peau, là où il y a des plaques rouges, de l'eczéma, du psoriasis, des allergies. Et puis l'on va accrocher le tissu dans l'arbre. Au milieu des autres loques. Certains font même une prière.
Quand certains nouent le chiffon, d'autres le fixent avec un clou, d'autres encore déposent la loque sur une branche. Comme dans toute pratique thérapeutique, “il faut que ça passe”. Il y aurait un transfert entre le mal fixé sur la loque et l’arbre au pouvoir guérisseur. Transférer la maladie à un végétal pour la faire disparaître.
“Surtout, ne touche pas les loques qui sont accrochées à l'arbre, tu risquerais d'attraper les maladies dont elles sont porteuses. Y’a que ceux qui croient à rien qui peuvent toucher l’arbre sans risque. Mais ceux qui croient pas, ils viennent pas.” Le vent se lève, les feuilles du chêne bruissent. Le bruit de l'eau…
“Et faut faire attention, faut être en tête à tête avec l'arbre, il ne faut pas être vu des autres personnes, sinon le message, il ne passe pas !” En venant, chacun contribue au mystère.
Dans ces campagnes de bocage, le christianisme condamnait à tour de bras tous ces cultes païens voués aux arbres, aux sources ou aux pierres. Jusqu’au 19e siècle, la médecine moderne était quasiment inexistante chez les paysans. Il y avait deux mondes qui étaient bien séparés. D’un côté, les médecins qui étaient surtout urbains, ils étaient rares et chers et puis de l’autre, la confiance que l’on portait aux sources, aux arbres, aux animaux, à la nature avec laquelle on vivait.
Ces pratiques ont longtemps résisté dans le nord de la France, en Basse-Normandie, ou encore dans la Somme. En Belgique et en Irlande également.
Pour assurer la transmission du rituel et prendre la succession de l’actuel arbre, en fin de vie, on a planté en 1920, un deuxième chêne à proximité du premier. Et puis un troisième il y a quelques années.
Ce jour-là, on a accroché un mouchoir que notre mère avait gardé jusqu’au dernier jour. Il y avait une petite initiale brodée dans le coin.

La mort est dans le pré !
La plus grande ferme de France s’est installée, porte de Versailles à Paris, jusqu’à dimanche. Les Français adorent les paysans. Et tout le monde veut voir les animaux d'élevage du Salon de l’agriculture. La campagne à Paris.
Pour l’inauguration du Salon de l’Agriculture 2019, le président Emmanuel Macron a battu tous les records : il est resté quatorze heures…
Vraiment, les Français aiment bien leurs agriculteurs. L’Hexagone compte environ 885 000 exploitants agricoles (chefs d’exploitation, conjoints, salariés permanents…). On les aime bien, surtout au moment du Salon… Non, on exagère, on les aime aussi beaucoup pendant la diffusion de « L’amour est dans le pré ». Quand on découvre Gérard, alias Gégé, éleveur de brebis dans le Limousin, se confiant en larmes, à Karine Le Marchand, sur sa solitude. L’émission de M6 rassemble près de 4 millions de téléspectateurs fidèles. Tellement touchants, ces agriculteurs.
Et pourtant, depuis quelques jours, un chiffre revient en boucle. Un chiffre qui ne fait qu’augmenter et qui devrait nous alerter : un agriculteur se suicide en France tous les deux jours ! C’est sans doute une des professions les plus exposées, puisque le taux de suicide est supérieur de 20 à 30 % au reste de la population. Principalement des hommes.
Producteurs de lait et éleveurs de bovins : c’est là où l’on trouve le plus de victimes. Mais ça ne déclenche rien. C’est pourtant concret le lait et la viande, ça devrait parler à tout le monde. Entre 2008 et 2009, 35 salariés se sont suicidés chez Orange. Indignation générale. Procès. Idem à La Poste. Pour les agriculteurs, rien. Pas de réaction, pas de mobilisation, pas d’actions en justice.
Rien. Ils font partie des invisibles. Même les statistiques ne disent rien. Certaines sources avancent le chiffre de 732 morts pour la seule année 2016. Ce n’est plus un suicide tous les deux jours… cela serait deux suicides tous les jours. En silence.
Le lait, la viande, le pain, les fromages, les légumes, c’est dans notre quartier, sur notre marché que nous les achetons. Nous avons tous oublié qu’au début de la chaîne, il y a des agriculteurs, des paysans en somme, et que pour nombre d’entre eux, les fins de mois sont justes intenables.
Que s’est-il passé en France, pour que l’on accepte qu’une grande partie des agriculteurs gagnent une misère, au point de mettre fin à leurs jours ? Peut-être la même chose qui fait que l’on accepte que les baskets soient fabriquées en Asie, par des populations sous-payées… La distance. La distance entre la ville et les champs.

Réenchanter le monde…
On l’avait remarquée la semaine passée, un matin, en allant prendre le métro. La fille au pull mauve et en Dr. Martens, un casque audio sur les oreilles.
Elle avait un beau visage, mais son regard était trouble, lointain. Rien de surprenant, quand on habite Paris. On s’habitue à cette absence dans le regard. Une forme de résignation. Ailleurs. Pas le temps. Facebook, Twitter, des mails à lire… Ne pas s’attarder. Toujours pressé.
Au siècle dernier, les gens étaient souvent silencieux à la maison, quand l’espace public était un lieu de contacts, d’échanges. Il y avait même des gens qui chantaient aux pieds des immeubles. Aujourd’hui, tout s’est inversé.
Chez eux, les gens sont connectés, en réseaux jusque tard la nuit. Et dans les rues, dans le métro ou le bus, personne ne parle plus… L’espace public est devenu plus silencieux. Plus de chanson… Le monde serait devenu désenchanté. Il est intéressant, ce mot “désenchanté”.
Un monde qui ne chante plus. Où l’on croise des visages tourmentés. On croit reconnaître des expressions sur ces visages, des expressions de cris sourds, muets, des cris absorbés comme dans du feutre. Le silence.
Alors, comme tous les jeunes, la fille au pull mauve porte un casque audio, pour être sûre de ne pas laisser de place au silence. Un silence inimaginable qui fait peur. Chacun comble son espace, de musique et de sons. C’est devenu la norme, comme l’on porte des lunettes pour corriger la vue.
Ce matin, on fait un signe. On refait un signe à la fille. Elle déplace l’écouteur de son oreille gauche. “Oui ?” C’est inattendu, mais on s’approche.
– Bonjour, vous écoutez quoi comme musique ?
– Pourquoi ? … Cela va vous surprendre, sans doute… C’est une ballade médiévale anglaise, “Scarborough Fair”, reprise par Simon & Garfunkel dans “Le Lauréat”, le film avec Dustin Hoffman. Je l’écoute en boucle. Dans la chanson, un garçon interpelle l’auditeur pour servir de messager auprès de son ancienne amoureuse. Il veut qu'elle réalise des tâches impossibles, comme confectionner une chemise sans couture ou se laver dans un puits asséché... J’adore cette idée de chemise, c’est inaccessible. J’adore !

Martin Grignan
Piscine de la Cour des Lions, Paris 11e, un dimanche de février. On a pris l’habitude, depuis le début de l’année, de venir nager chaque week-end…
Une demi-heure en essayant de glisser, au mieux. Limiter le nombre de mouvements sur une longueur. Glisser pour économiser son énergie. Midi trente. On sort du bassin moins fatigué que les dernières fois. Et toujours le même rituel, douche, gel douche, shampoing, vestiaire.
La voix vient de la cabine d’à côté. C’est en sortant dans le couloir que l’on aperçoit un petit garçon, assis près de sa mère. Elle lui sèche les pieds avant de lui enfiler ses chaussures de sport.
« — Antoine Griezmann, j’aurais voulu m’appeler Antoine Griezmann ! Mon prénom Antoine et mon nom Griezmann. ANTOINE GRIEZMANN. Annnnnntoineeee Griezzzzzzzmann !
— Arrête de bouger et de me crier dans les oreilles. Enfin, tu sais, t’as pas trop le choix, tu t’appelles comme tes parents !
— ANTOINE GRIEZMANN… ANTOINE GRIEZMANN… Pourquoi je m’appelle Martin Grignan ? C’est nul, ce nom ! An toi ne Griez mann, AN TOI NE GRIEZ MANN… ou… ou aussi Kylian Mbappé. C’est bien ça, Kyliaaaann MMMMbaaapppé…
— Bon, écoute Martin, on va y aller. Tu me fatigues avec tes noms de footballeurs. »
Amusé, on regarde le garçon. Alors bien sûr que l’on pense à « Baisers volés », le film de François Truffaut en 1968 où le héros, le jeune Antoine Doinel, grandissime Jean-Pierre Léaud, déclame avec frénésie devant son miroir, les deux noms de celles qui le possèdent entièrement, la femme mariée et rêvée, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard… et puis son flirt, Christine Darbon, Christine Darbon, Christine Darbon… jusqu’à ce qu’il se reconnaisse, là dans le miroir… et scande de plus en plus vite, de plus en plus fort, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel… Jusqu’à l’obsession, comme si le fait d’énoncer ces noms les rendaient plus présents, plus réels encore.
En partant, dans le hall d’entrée de la piscine, on a sorti un bloc de Post-It. On en a collé cinquante sur la grande baie vitrée. On a écrit au feutre noir : Martin Grignan.

Le temps de lire
On pensait à ça ce week-end, en relisant des passages du « Vernon Subutex » de Virginie Despentes. « On ne peut pas vivre dans un monde où les objets sont conçus pour être remplacés le plus vite possible. »
On est au XXIe siècle et, même si cela peut sembler paradoxal, la dématérialisation n’a pas tout englouti… on ouvre encore des livres pendant des heures, des jours même. « Non, non, je te rassure, je ne suis pas devenu bouddhiste… Je ne vise pas le Saint-Graal de la Rolex à 50 ans. »
Quelle étrange idée que de prendre le temps de lire un livre ! On se retrouve de fait, en décalage avec le monde.
— Tu fais quoi, là ?
— Je relis un livre que j’ai beaucoup aimé, cet été !
— Ah bon... ça ne va pas, en ce moment ? T’es sous antidépresseurs ?
On en arrive à s’enfermer dans une pièce, à s’isoler dans le train, à ne plus voir personne, à ne pas consulter de façon compulsive son smartphone. On en arrive même à préférer ça, plutôt que d’aller boire quelques bières avec des potes (là quand même, faut vraiment que le livre soit hors du commun).
Comme si le livre, les mots du livre, nous proposaient quelque chose qu’on ne trouve pas ailleurs. Il y aurait comme un temps particulier qui ne ressemble en rien au temps de notre quotidien. Car il faut bien le dire, le temps dominant que nous vivons aujourd’hui, c’est celui de l’économie. Le temps qui défile à vitesse grand V, comptabiliser, classer, compter, recompter. Chronométrer. Le temps des winners, des challengers, des compétiteurs, des gagneurs. Pas trop le temps des lecteurs…
La littérature a ce pouvoir de freiner le temps, de le retarder. La littérature vient comme une opposition au rouleau compresseur qui nous pousse à courir du matin au soir. Le petit-déj en consultant son fil Twitter et en écoutant la revue de presse à la radio. Prendre le métro en courant dans les escaliers. Commencer à bosser avec le rythme des mails qui tombent, comme les assiettes qui s’empilent dans l’évier. « Allô, t’as pas eu mon mail, il y a dix minutes ? Comme t’as pas répondu, je crois que t’as pas bien compris que c’était super urgent. » Marre des « À très vite ! À très bientôt ! À tout de suite ! »
Un contre-pouvoir du livre, comme on parlerait de contre-culture. Un truc qui vient s’opposer à l’accélération ambiante, qui agrippe le temps pour nous plonger dans une narration. Juste le temps d’ouvrir un livre.

Débordement de news
On s’était dit que c’était sous doute lié à la nature anxiogène de l’information du matin. Ce côté bien accablant qui fait que tu as envie de te recoucher aussitôt…
L’horreur dans le monde, les conflits, les attentats, les catastrophes, la population grandissante sous le seuil de pauvreté, les licenciements massifs… en gros, un millefeuille de trucs bien déprimants. Et puis on est tombé sur un chiffre.
Et là, c’est comme pour l’état de la planète… on n’arrive plus à visualiser. On n’y arrive plus. En fait, ce n’est pas l’info déprimante qui nous plombe, mais plus simplement la quantité absolument monstrueuse des infos en circulation. Le déluge. A tel point que l’on ne sait plus où donner de la tête…
« Il faudrait une capacité mémoire de 5 exabytes (soit 5 milliards de milliards de bytes) pour enregistrer tous les mots qui ont été prononcés par les êtres humains depuis l’origine jusqu’à aujourd’hui. En 2011, il était généré 5 exabytes de contenus tous les deux jours. Aujourd’hui, on estime que cette quantité d’informations est produite toutes les deux heures. » C’est Eric Schmidt, le président exécutif d’Alphabet, la société mère de Google, qui donnait ces chiffres il y a cinq ans. Un expert !
Et là, tu relis et tu te pinces. Aujourd’hui, on produit en deux ou trois heures, autant d’informations que l’on en a produit depuis la naissance de l’humanité. Les premiers homos sapiens, c’était il y a 200 000 ans, peut-être même 300 000 ans. On est littéralement submergé dès le levé du jour et la connexion qui va avec.
D’autant, que les contenus émotionnels négatifs se transmettent plus rapidement et plus massivement que les contenus émotionnels positifs, tout pareil pour les fakenews. Qui elles circulent six fois plus vite que les informations avérées, parce qu’elles sont simples et sensationnelles.
Au milieu de l’algorithmie dominante, reste-t-il encore une place pour une idée intelligible ? Comment se faire entendre, comment même imaginer que quelque chose puisse être audible ?
Alors que celui qui surnage, c’est celui qui hurle le plus fort, celui qui sort l’énormité la plus grosse, il n’y a que la démesure qui arrive à traverser ce flot ininterrompu. La provocation, l’injure et l’injonction…
Alors, on cesse de croire à ce que l’on entend et à ce que l’on a sous les yeux. Comme Donald ! On s’en fout de savoir si c’est vrai ou si c’est faux… le bullshit !
On ne tiendra pas très longtemps à ce rythme là. Il va bien falloir tarir la source au risque de ne plus reconnaître la beauté. Il va bien falloir prendre du recul.
Vous avez tout vu !
Une petite erreur au chargement